lundi, 01 avril 2019
Poème de carême (2)

Photo prise à Béthléem, dans la grotte de saint Jérôme, dans la bénédiction d'un matin...
07:16 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carême, christ, christianisme | 
mercredi, 06 mars 2019
Poème de carême
De T’avoir ignoré dans ta nature trinitaire, Seigneur,
Je me repens
D’avoir dissipé mon talent ;
Que goutte entre nos lèvres Ton lait nourricier,
Ô Marie !
Qu’à ta couronne sainte
Ma volonté se rallie !
De T’avoir offensé dans ta miséricorde, Seigneur,
Je me repens
D’avoir dissipé mon talent ;
Que s’écoule en nos veines le sang versé pour nous,
Jésus !
Qu’au soutien de ta Croix
Ma vie se voue !
De t’avoir égaré dans la forêt du monde, Seigneur,
Je me repens
D’avoir dissipé mon talent ;
Que l’eau de ta plaie lave et guérisse nos âmes,
Ô Christ !
Qu’à ta Parole jusqu’au bout
Ma langue se noue !
D’avoir conçu le Bien et le Mal à ma guise, Seigneur,
Je me repens
D’avoir dissipé mon talent ;
Qu’en la mort de nos corps resplendisse le Tien,
Ô Fils :
Que s’écartent de moi
Tout péché, tout vice !
D’avoir espéré ailleurs qu’en Toi, Seigneur,
Je me repens
D’avoir dissipé mon talent ;
Puisse l’Esprit Vivant d’avant la faute,
Ô Père,
Éterniser mon repentir
Et sanctifier ce carême !
Amen !

Masaccio- Trinité, Santa Maria Novella, Florence (1425-1428)
Poème de Roland Thévenet - Mercredi 6 mars 2019
22:05 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | 
dimanche, 10 décembre 2017
Jérusalem
Jérusalem,
Ville Passion du Christ.
Où s’ouvrit le Ciel
Et la Terre se fendit,
Golgotha !
Marie souffle toujours au chrétien
Que pour le rachat des Siens
Son Fils y expira.
En cette pensée, mon âme,
Baise la pierre où fut déposée
Sa chair d’Agneau lacérée
Et sa Divinité intacte,
Inébranlée.
Ressuscité, il traversa
Le suaire ici-même,
Jérusalem !

Jérusalem !
Gardé par trois églises,
Son Saint-Sépulcre irise,
Flambe d’un Feu
Trine et surnaturel :
Simple pèlerin en ce lieu,
Âme éprise de Dieu,
Qu’il fasse de toi Sa semence !
Laisse pour cela se dérober,
De ton corps prosterné,
Toute autre présence
Que le Verbe Incréé,
Qui fut avant le mur
Du temple second,
Et sera après le Rocher même,
Jérusalem !
17:53 Publié dans Des poèmes, Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : jérusalem, saint sépulcre, christ | 
samedi, 01 juillet 2017
L'inclinaison
L'au-delà
S'y glisser pour renaître
Par la fenêtre
De chaque nuit
02:44 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | 
mardi, 28 mars 2017
Diatna (2)
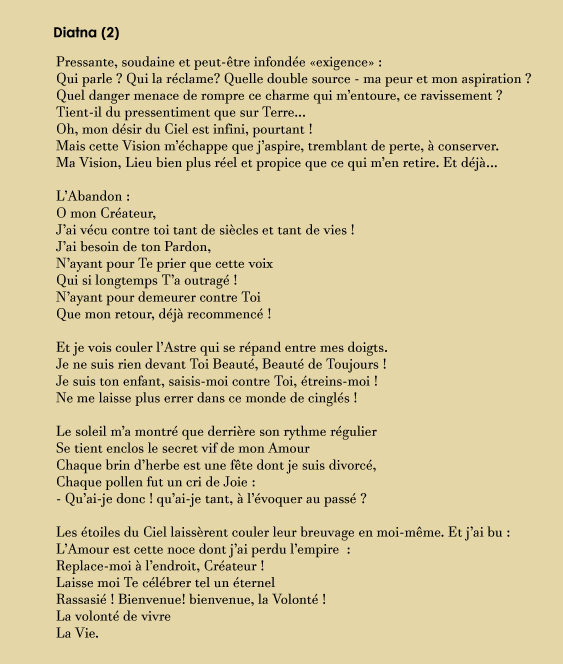
21:18 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | 
samedi, 25 mars 2017
Diatna (1)
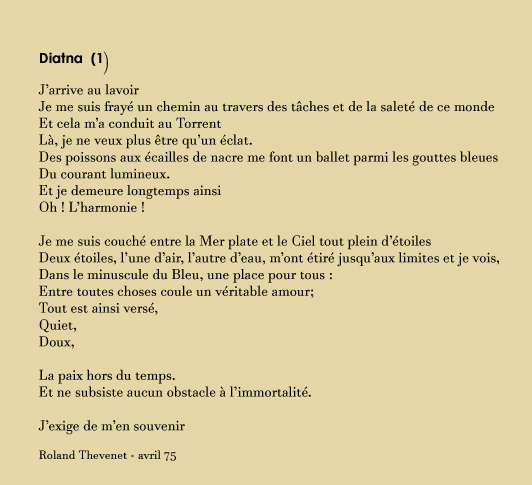
12:44 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (4) | 
dimanche, 19 février 2017
Depardieu est grandiose
Confidentiel. Le véritable public de Barbara fut jusqu'au bout un public confidentiel. Mieux que quiconque, Depardieu, qui fut son partenaire dans Lily Passion sait lui parler : ces 9 soirées qu’il vient de donner aux Bouffes du Nord à Paris tinrent du grandiose. Une reprise ou une tournée suivront-elles ? Nul ne le sait. En tout cas, si Gérard Depardieu passe non loin de chez vous, précipitez-vous. Précipitez-vous, vraiment. Nous avions la silhouette de la longue et fine dame brune debout, un bras levé et une jambe inclinée légèrement devant l’autre, ou effondrée dans un rocking-chair. Nous aurons désormais celle, massive et immobile, de Gérard Depardieu lâchant dans la fluidité de sa parole envoutante la meilleure partie de ce répertoire unique dans la chanson française, dont tous ceux qui tentèrent depuis la mort de sa créatrice de l’approcher pour en tirer quelque profit personnel se ridiculisèrent publiquement ; mais Depardieu, ce géant de la scène qui n’a depuis longtemps plus rien à prouver à quiconque ni à voler à personne, s’affirme devant ce répertoire tel un modèle de frémissante humilité et de subtile intelligence. Le point de départ de son interprétation est la reconnaissance d’avoir connu, aimé, et travaillé avec la disparue, C’est cette reconnaissance de ce que fut Barbara, auteur interprète et femme subtilement engagée dans les passions de son temps, qu’il porte jusqu’à nous et nous fait partager. Avec lui, l’hommage retrouve sa signification médiévale et devient presque un genre lyrique, surprenant au sein de ce show-business mondialisé où le siècle égalitaire fait régner tant d’insipides vanités et de grotesques médiocrités. Non, l'art n'est pas donné à tous, et la virtuose pugnacité de Depardieu qui se hisse au niveau de Barbara en fournit l’éclatante démonstration.
Il y a au moins trois façons de recevoir ce spectacle : soit ne regarder que la prouesse de Depardieu, Soit laisser revivre en soi celle de Barbara. Soit, et l’exercice devient à un moment inévitable, comparer les deux.
Ne voir que Gégé ( comme le dit affectueusement son public ) c’est se fondre dans l’émotion qu’il lâche lorsqu’il s’écrie : « Maintenant libre de toi, c’est là que tu me manques », paroles composées par Guillaume, son fils aujourd’hui mort, pour le dernier album de Barbara. Ou bien, tandis qu’il livre une interprétation phénoménale de Drouot, glisser en sa compagnie dans la mise en abyme de « ce passé qui n’est plus » et dont il maîtrise toutes les clés, qu’il ouvre de notes en notes, de mots en mots: Quelle est donc cette femme « superbe et déchirante », dont les mains, belles encore, et les doigts nus sont tels, parfois « les arbres en novembre ? » et quel passé revoit-on soudain, qui défile, qui défile ? Et de quelle solitude, « renifleuse des amours mortes » est-il fondamentalement question « un soir que je rentrais chez moi » ?
Réentendre Barbara, tant Gérard semble restituer de si près la compréhension de ses textes hautement revendiqués comme n’étant pas « intellectuels » ? Cette compréhension de l'instant, cette intelligence de la vie se réinstallent en effet parmi nous, tel un personnage que le comédien fait soudain revivre tout en le tenant à distance, à la manière dont Diderot l'analysa jadis dans son Paradoxe, si magnifiquement. C’est parce que Depardieu demeure avant tout ce qu’il est, comédien, qu’il nous restitue Barbara bien plus justement que toutes ces petites sottes vêtues de noir qui fredonnent Nantes ça et là en s’identifiant à ce qu’elles ne sont pas : la justesse de la coïncidence entre la longue dame brune et ce géant obèse en train de murmurer : « j’aime mieux m’en aller du temps que je suis belle / qu’on ne me voit jamais faner sous ma dentelle », reste stupéfiante, et l’on demeure incrédule de pouvoir admettre et se glisser si aisément dans cette fiction : une voix vive et mâle s’accordant si facilement à une autre, féminine et disparue, par la magie de la technique du jeu et la grâce de l’admiration partagée. C’est, au sens propre, inouï. D’autant plus qu’entre les chansons, Depardieu insère des extraits d‘interviews, parle, incarne Barbara dans la seule lueur d‘une poursuite, comme au temps de l’Écluse : « Je suis, dit l'énorme Gégé, une femme qui chante. » Au-delà d’une performance. Un chef d’œuvre.
Les comparer. Qu’on songe à s’y risquer est déjà, en soi, preuve de la réussite. Et pourtant, Depardieu touche parfois aux limites de sa technique et de son jeu. C’est alors qu’il devient le plus beau. Le plus humble. Comme à la fin du Soleil Noir, dont après avoir restitué toutes les nuances -et Dieu sait si elles sont nombreuses, et belles, et difficiles- il renonce à gravir derrière Barbara les cimes du « désespoir », ou bien à la fin de Nantes, celles du « chagrin ». Car désespoir et chagrin, comme amour et tendresse demeurent en leur spécificité la signature de chacun, chez Barbara qui consacra sa vie à l’affirmer, cramponnée à son piano, plus que chez nul autre : comme la chanson Perlimpinpin le revendique si noblement, le vécu de chaque être est unique, là réside l’essentiel de sa vérité : vient donc toujours l’instant où le plus haut des comédiens doit céder le gant devant ce qu’on pourrait appeler, malgré le bien commun, la propriété intellectuelle. C’est alors que Gérard s’incline et qu’il touche au sublime de son art, dans l’humilité non feinte et la majesté incomparable des très, très grands artistes.
Ainsi, parce qu’il n’essaie pas de faire revivre la chanteuse, le comédien la fait si parfaitement exister, en compagnie de Gérard Daguerre qui fut de longues années son musicien, qu’il parvient littéralement à faire renaître son public qui se retrouve à chanter pour elle et devant lui après les rappels Une petite cantate, comme au temps de « Pantin la bleue » en 1981. Une sorte de sommet.

11:32 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : bouffes du nord, depardieu, daguerre, gégé, nantes, soleil noir, perlimpinpin, chanson française, culture, lily passion, diderot, paradoxe du comédien, depardieu chante barbara | 
mercredi, 28 décembre 2016
Je le hais comme vous haïssez Dieu
Nulle part, sans doute, Baudelaire n’est plus catholique.
Il faut imaginer une pièce sale, comme au temps de la prohibition américaine. Cet étranger, les mains liées derrière le dos, devant un flic en uniforme prêt à le gifler. « Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique » dit-il ; l’interrogatoire commence. « Ton père, ta mère, ton frère ta sœur ? ». À cette époque, on ne disait pas encore ton papa, ta maman, et toutes ces sucreries niaises et insipides. L’étranger n’a ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Il le dit, sèchement. Quatre fois ni. Alors l’interrogateur continue : Il ne supporte pas l’énigme. Tes amis ? Le sens de cette parole, lui réplique l’étranger, lui est resté jusqu’à ce jour inconnu. Aujourd’hui, l’étranger ne pourrait entrer sur le sol des États Unis : il ignore facebook. Comme disent les jeunes avec mépris, c’est un sans amis. L’étranger ne dit plus ni, il dit in- un privatif. Alors, l’interrogateur se rabat sur la patrie. Quand on est orphelin, ignoré de tous, au moins a-t-on une patrie. L’interrogateur, c’est le sens commun, la vox populi, la doxa. « Ta patrie ? » Le ton peut sonner comme « Tes papiers ? », mais peut aussi être plus doux. On peut peut-être imaginer une parole de compatriote. Qu’importe. Cette fois-ci, l’étranger ne dit pas non, mais il ignore. « J’ignore, dit-il, sous quelle latitude elle est située ». L’énigme s’accentue. Il faudra que l’interrogateur lui propose la beauté pour qu’une fois, une fois, il ne dise pas Non. Mais voilà qu’il s’exprime au conditionnel. Celle-là, dit-il, je l’aimerais volontiers, à condition qu’elle, fût rajoute-t-il, déesse et immortelle. Ces deux mots, chez Baudelaire, ce n’est pas rien. L’étranger ne veut pas des filles des rues ni des œuvres d’art à trois sous. Déesse, dit-il. Et immortelle…
Et c’est alors que Baudelaire touche au génie. On peut n’aimer ni sa famille, ni ses amis, ni sa patrie, ni la beauté, soit. Mais l’or ? Hein, l’or ! L’interrogateur est certain de le toucher au cœur, cette fois-ci. L’or, c’est la passion commune, celle qui ne se refuse pas. Tout le monde, n’est-ce pas, veut son ticket pour l’Euromillions. Satan, en quelque sorte, est sûr de son coup. L’étranger devient alors extraordinairement christique : « je le hais, lâche-t-il, comme vous haïssez Dieu » On entend en creux, bien sûr, le célèbre « On ne peut adorer Dieu et l’argent » Ou bien la parabole du jeune homme riche, qui, pour aimer Dieu, ne parvient pas cependant à lâcher tout son or et suivre le Christ. La haine de l’étranger pour l’or est donc à la mesure de notre haine de Dieu. Comme nous haïssons Dieu, à ce degré-là de mépris, d’inconscience ou de malignité, l’étranger nous hait nous, c’est-à-dire notre monde, notre système de valeur, d’assurance, de morgue. L’or ! L’autre ne peut que se taire. Eh ! dit-il, « qu’aimes-tu donc, extraordinaire étranger ? » Il y a là comme un aveu qu’étant homme, on doit finalement quand même aimer, aimer quelque chose. Et c’est la seule fois que l’interrogateur tape juste : oui, l’étranger aime. Il aime quelque chose de passager, d’insaisissable, à sa mesure. Il bredouille : « les nuages, les merveilleux nuages » En eux seuls s’incarne le miracle de l’amour pour cet étranger paradoxal, loin des passions communes, au plus loin des hommes et comme s’il ne pouvait en être autrement.
Entendons-nous bien, cet étranger, ce n'est pas là une affaire de migrant ordinaire. Baudelaire tiers-mondiste, je ne crois pas ! À chaque fois que j’ai expliqué ce poème en classe, j’ai toujours interrogé les élèves sur le statut du dialogue, suggérant qu’au fond c’était sans doute un dialogue intérieur entre la pire part de nous-même, celle qui veut s’insérer, se socialiser, s’intégrer, comme nous disent les socialistes. Et l’autre qui résiste, ne veut pas, la dissidente qui guette l’au-delà, se sait de passage, mortelle, jamais citoyenne, rendant à César ce qui ma foi lui appartient, pas grand chose, prête à suivre le Christ, à pleuvoir, en quelque sorte. Je le hais, dit-il, et l'on se prend à penser que pour que l'étranger admette l'or, et toutes nos passions tièdes et communes, il suffirait que nous cessions de notre côté de haïr Dieu, puisque que tout est dans ce comme, et qu'il deviendrait alors possible d'aimer son prochain comme soi-même, ce soi-même fait de deux parts enfin réconciliées.
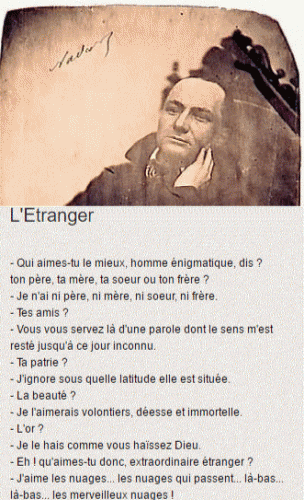
02:29 Publié dans Des poèmes, Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (3) | 
lundi, 08 août 2016
Confession d'un orgueil
Tout craintif et contrit, au berceau du péché, Mal su jusque de moi-même, Que suis-je de plus, que le Christ aime, Qu’on doive encore me pardonner ?
Quel Dieu pour mon sang, vivant ? Mourrai-je en l’ignorant ?
Dans le caveau de ma terreur, terré, Triste contre l’Auteur de toute vie, J’aspire à Celui de l’Hostie Mais par quelle louange L’aborder ?
Quel Dieu pour mon sang, vivant ? Mourrai-je en l’ignorant ?
Dans l’Enfer appesanti trône l’instable Orgueil d’une Toute-puissance inversée gorgée de prières falsifiées : Quel Amour me retint d’en franchir le seuil ?
Quel Dieu pour mon sang, vivant ? Mourrai-je en l’ignorant ? Toute transgression, lors, demeurera vaine, L’espoir d’en réchapper un seul instant aussi, Car c’est paradoxal, mais de haines en peines, L’enclos des révoltés est devenu celui des soumis
Quel Dieu pour mon sang, vivant ? Mourrai-je en l’ignorant ?
L’âme libre se fige, glacée de ses erreurs : En quel puits va-t-elle bien jeter tout son péché Avant d’ouvrir son cœur à son Seigneur ? Peut-elle-même se montrer, s’entendre, se regarder ?
Quel Dieu pour mon sang, vivant ? Mourrai-je en l’ignorant ?
La liberté n’est plus dans l’insoumission des corps Ni en la foi convenue de la duplicité Mais dans l’acceptation entendue de la mort Au sein de l’Unité faite Trinité.
Dieu purifie mon sang, vivant… Ô mourir en le suivant !
La félicité file, elle fuse et germe Dans l’Ame stupéfaite d’être sue et retrouvée : Le doigt s’ouvre, la main se tend, l’œil se ferme, L’eau du Christ coule sur elle, qu’Il abrite en sa plaie, lavée.
Dieu purifie mon sang vivant… Ô mourir en le suivant !
Les voici tiens, l’Histoire Sainte, et Béthanie, Jérusalem… Et tu frémis d’horreur et de Joie devant ce Golgotha. Et tu pries pour les prêtres qui portent le baptême, Ta vie te semble infime, et grande par la Croix.
(Roland Thevenet Juillet 2015)

Giovanni da Rimini, Histoire de la vie du Christ,
Palais Barbérini, Rome
22:02 Publié dans Des poèmes, Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christ, giovanni da rimini, palais barbérini | 











