dimanche, 30 janvier 2011
Qui a peur de Virginia Woolf ?
L’aventure théâtrale débutée à Bordeaux le 5 mars 2009 (et qui prendra fin à Rennes le 19 février 2011 après un passage par Narbonne, Bergerac et Tarbes) a tiré son rideau lyonnais aux Célestins, hier soir. Dominique Pitoiset et sa compagne Nadia Fabrizio y reprennent les rôles de Georges et Martha, le couple décapant inventé par Edward Albee en 1962, qu’incarnèrent Richard Burton et Elizabeth Taylor.
Première réussite : les deux complices parviennent à faire oublier ce redoutable duo cinématographique. Non en les surpassant, mais en se plaçant sur un autre registre, ce qui était sans doute la meilleure manière de procéder : plus cérébral, plus assagi, en un mot plus européen. Plus XXIème siècle, aussi.
Car il y a mille façons de « voir » le Virginia Woolf d’Albee.

La première, donc, serait encore hantée par la castagne amoureuse suavement pratiquée par le duo mythique du film de 1967. Elle garderait en mémoire ses coups de gueule, ses hébétements, ses injures et ses éclairs de complicité, reconduits de jeux en jeux (« humilier son hôte », « s’envoyer la baronne », « démolir les invités »…). Ce serait la lecture « scène de ménage » et « monstres sacrés », vaguement psychologisante et déjantée.
Le deuxième serait universitaire. Elle consisterait, sur les pas de Paul Watzlawick, à surligner chaque trace du système de la communication tel que le théoricien du Collège Invisible de Palo Alto la décrivit dans Une logique de la communication. George et Martha deviendraient une sorte de métaphore de toutes les communications possibles, leur système « ouvert » et « paradoxal », fait d’interaction, de rétroaction, de double-bind et d’équifinalité, serait exhibé à chaque réplique, jusqu’à la ruine du modèle installé depuis toujours. Intelligent, juste, mais lourdingue pour passer une bonne soirée théâtrale.
Pitoiset explique avoir travaillé sur une autre traduction, plus récente (et plus courte). Ainsi, dans le texte, on ne joue plus à « démolir les invités », mais à « casse-convives ». Soit. C’est surtout en déplaçant les enjeux que le directeur du théâtre de Bordeaux aura gagné son pari : la lecture qu’il propose place au premier plan l’affrontement entre générations que le terrifiant face à face Burton / Taylor avait occulté, et qu’avait laissé en mezzo voce les versions antérieures :
« À titre personnel, explique Pitoiset, et peut-être parce que je vais me charger de ce rôle-là, je suis particulièrement sensible à la lutte qui oppose George, l’homme des lettres et du « passé » (qui se rêve plus ou moins consciemment en père de son jeune hôte), à Nick, l’homme des sciences et de l’« avenir » (qui tient fugacement lieu de fils imaginaire de son aîné). C’est-à-dire au conflit entre ceux qui n’ont pas su ou voulu se mesurer au pouvoir et ceux qui trouvent tout naturel d’être ambitieux et de réussir à tout prix. Car il me semble que cette bataille-là fait rage aujourd’hui. »
Ailleurs, il parle d’une « opposition entre deux générations, les trentenaires pragmatiques vivant le monde froidement et pensant que la nouvelle économie l‘emportera sur les valeurs que souhaitait incarner la génération de Georges, et qui a finalement été défaite dans sa relation à l’épreuve de la réalité. »
La signature Pitoiset, c’est alors le travelling d’une caméra folle qui, entre chaque acte, projette le spectateur dans la peau d’un loup aussi frustré qu’ambitieux, si l’on en juge par ses halètements. Le loup dans la peau duquel il nous jette parcourt les salles et les corridors de l’université de Bordeaux, à la recherche de la sauvagerie enfouie que ni George ni Martha, ni Honey ni Nick ne parviennent à exhumer d’eux-mêmes. La signature Pitoiset, c’est encore le loup et les cochons, figurés quelques secondes par des masques : le premier faisant trembler les seconds, sous les traits du pragmatisme froid comme le sol en verre sur lequel les personnages évoluent, ou sous ceux du fauve lâché dans l’université sur la vidéo. Les seconds vulnérables comme chacun des quatre personnages à tour de rôle, jusqu’à Martha à qui revient le mot de la fin :
« Qui a peur de Virginia Woolf ?
-Moi, George. Moi. »
La signature Pitoiset c’est enfin la direction d’acteurs puisque tout, dans la mise en scène, se concentre sur leur performance. Retour au texte, à l’effet texte. On ne s’en plaindra pas ici. A propos de cette nouvelle traduction, Pitoiset expliquait (1) : « Daniel Loayza a créé une langue qui claque, avec des phrases très courtes, une langue de la lutte, une langue offensive, pleine d’ironie, truffée de références au cinéma et à l’histoire du théâtre. Je crois que, au-delà même du spectacle que je mets en scène, cette nouvelle traduction fera date. »
A Bordeaux, le 10 mars 2010, Pitoiset a créé le second volet de sa trilogie américaine, Mort d’un commis voyageur de Miller. Pour le troisième volet de ce cycle, il hésite encore entre plusieurs textes. C’est dit-il « un théâtre qui ne m’est pas familier, le théâtre de l’immédiat : J’entends par là un théâtre en prise direct avec le réel, qui n’a rien à voir avec une quelconque dramaturgie à étages. » Faut-il y lire une réaction contre une sorte de théâtre inévitablement « spectaculaire » ? Affaire à suivre.
(1) Entretien paru dans La Terrasse, janvier 2011
09:04 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : dominique pitoiset, edward albee, théâtre, virginia woolf, célestins | 
samedi, 29 janvier 2011
Andromaque, je pense à vous
Aujourd'hui, anniversaire de la mort de Racine. Occasion de publier à nouveau ce billet :

Dans l’écusson bleu, en bas et à gauche de la vignette, presque invisible, nage un cygne, un cygne solitaire. Suffisant, déjà, pour conférer à ce billet une élégance particulière et énigmatique. « Le vierge, le vivace, le bel aujourd’hui », le cygne, depuis Mallarmé devenu l’emblème même de l’alexandrin – ne rappelle encore, dans un coin de ce billet, que les armoiries concédées à Jean Racine par Louis XIV, « d’azur au cygne d’argent ». Le tragique au visage replet a le chef surmonté d’une haute perruque bleuâtre. Derrière lui (derrière Racine, derrière l'historiographe du Roi-Soleil), cette étroite cour de terre battue qu’on distingue entre quelques bâtiments, ne ressemble-t-elle pas à l’enceinte d’un lycée qui serait déjà napoléonien et dans lequel s’étudieraient depuis des siècles les tirades de Phèdre et d’Athalie : « N’allons pas plus avant. Demeurons, chère Oenone… Un songe (me devrais-je inquiéter d’un songe ?)». La cour, je dis bien la cour vide (quand chacun est en cours) d’un vieux lycée perdu dans une sorte de province coupée de tout et résolument éternelle – oui, cela existe, les provinces résolument éternelles - L'eau des rivières y demeure à jamais potable, et les monuments aux morts y sont régulièrement fleuris. Anacoluthe : on y étudierait encore du grec et du latin, on y composerait même des tragédies, imitées à l’exemple d’Eschyle ou bien de Sénèque. On se défierait dans des concours de rhétorique, quelques précaires mais suffisantes connaissances mythologiques y suffiraient. Derrière le visage de Jean Racine, non, non, ce n’est donc plus l’abbaye de Port Royal des Champs, non, ce n'est pas non plus le Louvre, c’est... En filigrane, la tête d’Andromaque : « Le spleen, expliquait d'un ton docte le professeur de français, c’est la douleur intense qui survit au renoncement à l’idéal. Il se peut que ce soit aussi une forme de salut pour le poète. Andromaque lui apparaît alors comme la dernière incarnation sensible de la grandeur dans ce Paris que la modernité a la fois embellit et prostitue». Quel vieux lycée, oh, quel vieux temple de l'alexandrin, dans lequel les vers de Racine, et ceux de Baudelaire, et ceux de Mallarmé se croiseraient en nouant la gorge des récitants comme sont noués les plis en ce pourpoint carmin de Racine, comme le désordre indocile et beau du col bouffant qui s’en échappe, et me rappelle trop vivement, trop brutalement, l’élégance, désabusée du paysage en ruine, et néanmoins dressé de jeunesse et d’orgueil, ces quelques mots ont valeur de mètre, et derrière ce poète, cet autre encore, ayant valeur de maître :

Aussi devant ce Louvre une image m’opprime
Je pense à mon grand cygne, avec ses gestes fous...
Ce billet magnifique a été imprimé du 7 juin 1962 au 3 juin 1976. Il remplaçait le 50 NF Henri IV et fut remplacé par le 50 Frs Quentin de la Tour. Jean Racine est né le 22 décembre 1639 et mort le 21 avril 1699, soixante ans.
12:17 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : littérature, théâtre, racine, billets français, lycée | 
vendredi, 28 janvier 2011
Sur la scène
J’ai trop souvent l’impression, lorsque je me rends au théâtre, que cet art a cessé d’être le grand rassembleur qu’il fut jadis, pour n’être plus, parmi d’autres, qu’un anodin représentant en images. Voilà pourquoi, contraint par l’époque, je peux passer de longs mois à ignorer son chemin qui me fut cher.
Et puis soudain, cinq, six spectacles, une sorte de boulimie presque involontaire, comme à la recherche d’ébranlements considérables dans la température des fondations éboulées.
Rejoindre le lieu d’où voir, et cet instinct égaré : « Le désespoir en dernier lieu de mon Idée qui s’accoude à quelque balcon lavé à la colle ou de carton-pâte », larmoyait Mallarmé (1) – et larmoyer est à entendre ici sous un jour positif –, tenter la clé du spectacle.
Longtemps, la culture des gens de théâtre – à cela la vive crainte que le bourgeois toujours leur porta – fut de ne rien conserver de lui-même : là, un soir efface l’autre, et chacun mérite la nouvelle et seule énigme d’une représentation ; on dit que c’est ainsi que le pape succède non pas à son prédécesseur, mais à Pierre lui-même. Comme si rien de trop ne comptait jamais, brûler les planches, flamber son cœur en guise de martyre, jouer fut longtemps le seul mystère du comédien.
Et dans un geste aussi aristocratique que catholique, centon échappé de la crèche, par le parvis de la cathédrale jusqu’au miroir de sa loge, l’homme de théâtre garda cela comme un honneur, à travers les siècles de possession. Telle fut sa coquetterie, qu’une maison jalouse dût ne durer, par nature qu’un instant.
Malgré l’aride travail qu’avait été l’édification de la précédente, assembler les poutres de la prochaine avec la ferveur d’un débutant, le compagnonnage d’un averti, le métier de l’artisan au déclin. Tant d’œuvres perdues, soit. Mais tant d’œuvres surgies de cette perte, consubstantielles. Tant d’autres, dans tous les sens du terme, passées. Tel, ce que la naissance doit à la mort.
Il est, de nos jours, question de captation de spectacles. Le metteur en scène, économe de son talent, devient réceptacle de son seul répertoire. Puisqu’il naquit de l’électricité, l’électricité le grille, en quelque sorte. Et, comme au cinéma, fige l’essor de sa parole. Moi, spectateur, il me faut alors redoubler de vigilance ; réserver mes applaudissements à quelques rares secondes : lorsque, quand même, loin de la performance, le souffle de l’acteur ranime mon instant.
(1) Mallarmé, Crayonné au théâtre
11:07 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : théâtre, littérature, société, mallarmé, spectacle vivant | 
mercredi, 08 décembre 2010
Kantor et l'abstraction
Drôle de hasard, alors que je vais passer pour la énième fois à des étudiants cet après-midi le film de Benis Bablet, « Le théâtre de Tadeusz Kantor », je découvre que ce dernier est mort il y a pile vingt ans, un 8 décembre 1990, durant les répétitions de Aujourd’hui c’est mon anniversaire.
Du dadaïsme, mais aussi de l’extrême précarité dans laquelle il a commencé, Kantor a pris ce goût pour l’objet pauvre, « incapable de servir, dit-il, bon à jeter aux ordures, débarrassé de sa fonction vitale, nu, désintéressé, artistique, appelant la pitié et l’émotion ».
Mais à présent, Kantor et son théâtre me semblent désormais si loin de nous : en parler devient difficile. Lui-même, lorsqu’il commente son œuvre est souvent répétitif ou confus.
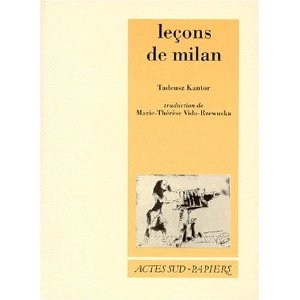
Pour retrouver ce théâtre, le plus difficile est de s’abstraire. S’abstraire de tout ce qui forme le monde aujourd’hui, et des débats dans lesquels nous nous empêtrons. S’abstraire aussi de la scène contemporaine, du spectaculaire et de la technologie qui y règnent. « La professionnalisation théâtrale de plus en plus marquée conduit à sa défaite », disait le maestro dans sa première leçon à Milan. (1)
C’est dans cette leçon qu’il insiste longuement sur cette notion d’abstraction. L’abstraction de Kantor n’est pas l’utopie de la forme pure, jadis prônée par le constructivisme. Elle en est même, dans son souci de révélation du concret le plus théâtral, le contraire absolu : s’il la définit d’abord comme le manque d’objet, l’absence de figure humaine, c’est pour justifier immédiatement la nécessité de leur retour : ainsi n’en finissent pas de revenir à nos mémoires les bancs de la Classe morte ou la roue de char du Retour d’Ulysse, porteurs non plus d’une fonction dans le monde réel mais d’une émotion sur la scène. En ce sens, Kantor a très vite cessé d’être plasticien pour devenir charnellement metteur en scène. « Je voudrais qu’ils regardent et qu’ils pleurent » répète-t-il souvent dans son entretien avec Denis Bablet. Ils, ce sont les spectateurs. Nous.
Quand ce n’est pas un objet, c’est un mouvement, un cercle, une ligne droite, ou la simple répétition d’un geste qui incarnent ce qu’il appelle l’abstraction.
Mais l’abstraction, là encore, n’est abstraite que pour mieux donner corps, voix, mouvement aux personnages. Elle demeure la condition d’existence de leur concret (non spectaculaire) sur la scène.
Il faut pour comprendre cela voir à nouveau et entendre encore cette parade de l’enfance morte dans l' Umarla klasa (la classe morte - suivre le lien sur Youtube). Ces vieillards pathétiques portant sur leurs épaules le poids de leur enfance martyrisée, de leurs illusions bradées, et revenant sur les bancs de l’école pour encore une fois ânonner une leçon qu'ils savent dérisoire, mais qui demeure leur dernier rempart contre la mort, sont restés gravés en moi comme un souvenir de théâtre impérissable.
Placer ainsi au centre de sa démarche l’abstraction, c’est aller évidemment à l’opposé du spectaculaire, lequel privilégie la vitesse, la variété, l’enchaînement. Rien de plus logique, dès lors, que la 12ème leçon de Milan, sous-titrée « avant la fin du XXème siècle » (et qui constitue le testament de Kantor peut-on dire) oppose à la démarche de l’abstraction autant celle de la consommation que celle de la communication.
Cet extrait de la dernière leçon de Milan, daté de 1986 :
« LA CONSOMMATION OMNIPOTENTE
Tout est devenu marchandise. La marchandise est devenue dieu sanguinaire. D'effrayantes quantités de nourriture qui nourriraient le monde entier; et la moitié de l'humanité meurt de faim; des montagnes de livres que nous n'arriverons jamais à lire; les hommes dévorent les hommes, leurs pensées, leurs droits, leurs coutumes, leur solitude et leur personnalité. Des marchés d'esclaves organisés à une formidable échelle. On vend des gens, on achète, on marchande, on corrompt. Création : ce mot cesse d'être un argument sans appel.
Et voici un autre visage de la FUREUR de notre fin de siècle : LA COMMUNICATION OMNIPOTENTE.
On manque de place pour les originaux qui marchent à pied (il paraît qu'un tel moyen de locomotion aide à penser). Des vagues et des fleuves de voiture se déversent dans les appartements. On manque d'air, d'eau, de forêts et de plantes. La quantité d'êtres vivants croît de façon effarante : des hommes .... Continuons : La COMMUNICATION qui s'accorde parfaitement avec les chemins de fer, les tramways, les autobus, a été jugée comme le concept le plus adéquat et le plus salutaire pour l'esprit humain et pour l'Art. Communication omnipotente ! son premier mot d'ordre : la VITESSE, s'est rapidement transformé en un cri de guerre sauvage de peuplades primitives. La devise est devenue ORDRE. Le monde entier, toute l'humanité, toute la pensée de l'homme, tout l'ART doivent exécuter docilement.
Tout devient obligatoirement uniformisé, égalisé et... SANS SIGNIFICATION. »
(1) Editées chez Actes Sud en mai 1990, les douze leçons de Milan, traduites par Marie-Thérèse Vido-Rzewuska ont été composées de juillet à novembre 1986. Tadeusz Kantor.
19:05 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : kantor, théâtre, umarla klasa, la classe morte, littérature | 
mercredi, 21 juillet 2010
La scène de la Croix-Rousse se vide
La Croix-Rousse vient de perdre deux figures majeures : Après Eric Meyer, le SDF de la grande place qui n’a pu (voulu ?) survivre au meurtre de son beau chien noir, Philippe Faure, le directeur du théâtre de la Croix-Rousse, qu’un cancer vient d’emporter. Eric Meyer, les gens du Plateau ne connaissaient peut-être pas son nom, mais tous connaissaient son visage. Tout comme tous connaissaient le visage de Philippe Faure. J’ai souvent croisé le regard de l’un et le regard de l’autre, lors de mes déambulations, sur le Plateau, le boulevard, le marché. Tous deux avaient le regard aussi triste. Je n’ai jamais vraiment parlé ni à l’un ni à l’autre. Je le regrette. Les échanges silencieux que j’ai pu avoir avec Eric Meyer paraissaient nous suffire. Quant à Philippe Faure, il n’a jamais daigné répondre à mes courriers concernant ma pièce, La Colline aux canuts. Aussi ai-je fini par la monter moi-même.
Dommage.
Quand un homme est mort, il n’est plus temps de polémiquer. Si je parle de ces deux hommes en même temps, c’est parce qu’il y avait de la rue, des errances, des volutes et des circonvolutions lisibles pareillement dans leurs yeux de chiens battus. Comme aux extrêmes l’un de l’autre - je veux dire de la reconnaissance sociale - et pourtant, si proches. Voilà même que je suis certain que leurs regards se sont évidemment croisés, sur cette place où Jacquard donne la patte aux pigeons. Oui. De la même manière que mon regard a croisé chacun des leurs, chacun a dû croiser le regard de l'autre. Forcément. La Croix-Rousse, comme on le dit souvent en prenant un ton hautement ridicule, la Croix-Rousse est un villaâââge... Ils se sont croisés devant ce bureau de tabac où l’un guettait la pièce, l’autre venait acheter son journal.
Dans le monde du Réel (celui où ni les pièces de théâtre, ni les pièces de monnaie ne tombent du ciel), ils étaient aussi emblématiques l'un que l'autre d’une forme de marginalité, de solitude. Et pourtant, tandis que l’un déjà s’enfonce dans l’oubli collectif, les hommages éphémères vont continuer quelques jours à pleuvoir sur l’autre :
Un homme de la parole vive, dit l’adjoint à la culture.
Un acteur hors-pair, un metteur en scène talentueux, dit le maire.
Un acteur passionné, un auteur inventif, un directeur engagé, dit le député.
Il était l’âme et le cœur du Théâtre de la Croix-Rousse, dit le président du conseil général…
Le plus grandiloquent est encore le président du conseil régional : "De l’homme qui proclamait fièrement, quelques semaines avant sa mort, que le destin du Théâtre de la Croix-Rousse est en marche : une Maison du peuple pour être utile , je me risquerais à dire, comme Camus à propos de Sisyphe, qu’il faut imaginer Philippe Faure heureux..."
Rebondissant sur ces propos de Jean-Jacques Queyranne, je me souviens à nouveau de cette tristesse dans leurs regards, et j’imagine l’un jouant l’autre, l’autre applaudissant l’un. Oui, non plus toujours assis par terre comme un clochard, mais dans un fauteuil de la Maison du Peuple, et je dis qu’il faut aussi imaginer Eric Meyer heureux, Eric Meyer heureux grâce à Philippe Faure.
Ce serait ça, l’art de la cité.
Ça, que le patron du théâtre de la Croix-Rousse tenait ferme, au cœur de son utopie.
Et pour conclure ce qui ne sont que paroles jetées, impressions fugaces tout autant que durables, car nous y passerons, nous le savons bien, tous et toutes à la suite d’Eric Meyer et de Philippe Faure, quelques paroles décisives de Beckett sur le sujet, homme de théâtre et d’écriture, et mendiant terrestre, s’il en fut :
« Oui, toute ma vie j’ai vécu dans la terreur des plaies infectées, moi qui ne m’infectais jamais, tellement j’étais acide. Ma vie, ma vie, tantôt j’en parle comme d’une chose finie, tantôt comme d’une plaisanterie qui dure encore, et j’ai tort, car elle est finie et elle dure à la fois mais par quel temps du verbe exprimer cela ? Horloge qu’ayant remontée l’horloger enterre, avant de mourir, et dont les rouages tordus parleront un jour de Dieu, aux vers. »
Samuel Beckett, Molloy,
Hommage à Eric Meyer & Philippe Faure qui ont tous deux comme autre point commun celui d’être mort prématurément : 42 et 58, ce qui fait à deux, pile, pas un an de plus qu'un siècle.

12:22 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : croix-rousse, eric meyer, philippe faure, théâtre, lyon, actualité | 
mardi, 20 juillet 2010
La Table de Claude (10)
Je voudrais faire du latin. J’y serai bien un jour, attelé à des tableaux de déclinaisons devant des photos de bustes gris ou d’épigraphes énigmatiques ! On aura beau sourire autour de moi : n’est-ce pas plutôt le temps des maths modernes ? J'y serai, tôt ou tard ; qu’est-ce que les maths modernes auraient donc à m’apprendre du monde qui m’intéresse pour de vrai ? de celui de Claude en l’occurrence, Claude dont les tables me demeurent plus mystérieuses que celles de Moïse, puisque aucun catéchisme ne les a jamais évoquées, elles ! J’en ignore pour de bon le plein contenu, sinon cette phrase aussi intrigante que sensuelle à mon ouïe : « il faut sauver la Gaule Chevelue… » Sauver ? je me demande…
Un de mes oncles, celui qui tient la première épicerie qu’on rencontre sur sa droite quand on passe les voûtes de Perrache, convainc ma mère que les maths modernes, c’est vrai, ce n’est pas si fondamental que ça… Que le latin, au contraire …
M’y voici presque, en attendant : dans le verger des sœurs de la Compassion, fut exhumé il y a une trentaine d’années le plus ancien théâtre de la Gaule : Ses débris contemplent le Levant. Il s’était tenu planqué là durant des siècles, est-ce possible ? à l’abri des curieux, tapi sous des sentiers seulement foulés de souliers de sœurs récitant le saint rosaire, là où je place mon soulier, là où je marque le sol à mon tour. En contrebas de la basilique, dans l’écrin de son arc creusé à flanc de colline, lui, l’Antique, fait désormais figure de revenant quelque peu démuni de tout, de ses pierres, de son mur, de ses masques et de ses sénateurs en toges, face au grand ciel qui ne coiffe jamais qu’une journée banale sur la ville besogneuse. M’y voici pourtant. Je longe son vaste corps. Mais il m’en faudrait davantage : pourquoi ne pas raser tous ces immeubles et ces maisons, somme toute vraiment moches, pourquoi ne pas rebâtir Lugdunum ? On me traite de fou. Ce que je ressens sous mes pas, pourtant, me rassure, à chaque fois que je viens ici. De longs après-midi, j’écoute le silence, j’hume jusqu’aux plus lointaines fondations. La table de Claude ? J’aime ces travées vides jusqu’au vertige : à personne je ne confie le secret de ces escapades. La table de Claude, il me semble qu’ici-même, dans ce théâtre, oui, dans ce pauvre bâtiment déconfit qui servit de carrière à toute la ville au cours des siècles, il me sera donné d'en comprendre quelques caractères de son alphabet : ce théâtre, quelle aventure cela a dû être ! bien plus que ces réunions ridicules devant le poste en noir et blanc quand Kennedy, Piaf ou le pape meurent. Le théâtre, le vrai, alors que sont peuplés ces gradins de tout ce que la ville compte d’hommes. Le théâtre ! Le latin ! La tête me tourne sitôt repassé par-dessus le mur d’enceinte, la rue et les voitures du temps présent, de mon temps, les voitures qui puent ...

00:00 Publié dans La table de Claude | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, théâtre de fourvière, théâtre romain, théâtre, latinité | 
dimanche, 23 mai 2010
Lady Clementina Hawarden

Lady Clementina Hawarden fut l’une des photographes les plus recherchées du XIXème siècle anglais. Née le 1er juin 1822, non loin de Glasgow, elle avait commencé à prendre des photos vers 1857, faisant souvent poser ses enfants, son mari ou ses domestiques. Son père avait été un amiral réputé, sa mère ce qu’on appelait alors « une beauté exotique », de 26 ans plus jeune que lui. Elle exposa en 1863 et 1864 ses intérieurs, tous pris dans sa maison londonienne, sous le titre « Studies from Lifes ». Elle mourut chez elle, d’une pneumonie foudroyante à 42 ans, au 5 Princes Gardens, South Kensington. On prétendit que son système immunitaire avait été affaibli par une exposition trop constante avec les produits chimiques.
J’avais entendu parler de lady Clementina Hawarden il y a longtemps, lorsque je travaillais sur l’adaptation du Moine de Mathew Gregory Lewis, et que je m’étais documenté (un peu) sur l’Angleterre du XIXème siècle. Les photos de lady Clementina Hawarden ont quelque chose de somptueusement hanté, au sens poétique (ou plus) du terme. Quand on les respirent un certain temps, les portes claquent derrière soi, les parquets grincent et, du sol des corridors s’élèvent des chuintements de soie. Après quoi, comment ignorer ses fantômes ?

18:58 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : hawarden, photographies, spiritisme, théâtre | 
mercredi, 25 novembre 2009
Notre Terreur
Aïe ! Tel est le dernier mot du spectacle. Les temps de la postmodernité, ludiques et désabusés, paraissent soudainement soucieux de revenir à leur origine pour s’y mirer : Nous sommes donc le 10 Thermidor. Et un peu également aujourd’hui. Puisque cette terreur devant le mal inextinguible qui emporta les grandes utopies révolutionnaires, cette terreur est dite nôtre. Puisque les êtres que nous sommes, dépassés par les événements post-historiques que nous vivons seraient à l’image des êtres que furent les Révolutionnaires, dépassés, eux, par l’événement révolutionnaire qu’ils ont vécu.
Le collectif D’ores et déjà ouvre aux Célestins un cycle de plusieurs représentations (du 24 novembre au 4 décembre 2009). La compagnie érigée en collectif joue les héros de Thermidor érigés en comité de salut public. Mise en abyme assez réussie, il faut le dire. Car il y a du plaisir, de l’énergie, de la jeunesse et de l’intelligence sur scène. Qu’il y ait de la peinture, de la grenadine et une marionnette, cela n’était sans doute pas nécessaire. Heureusement, il y a du texte. Et des acteurs. De véritables morceaux de bravoure également. Durant la première partie du spectacle, on prend plaisir à être le témoin des nombreux affrontements verbaux des personnages, balancés sans cesse entre l'improvisation, le discours et le débat, et leurs joutes oratoires surdéterminés de citations littéraires - la plus inattendue demeurant la ballade de merci de Villon en presque final. Je reste plus dubitatif devant la cohérence du tout, et notamment devant cette deuxième partie qui se délite au fil d'une vision baroque et plus convenue des événements. Notre Terreur, au fond, ne parle quasiment que du vide de notre époque, qui depuis longtemps déjà prend l’Histoire pour un spectacle, le destin pour un jeu de rôles, la parole pour une mise en scène quelque peu hystérique de soi. La réussite du spectacle ne tient donc pas à son propos sur la période révolutionnaire, propos général assez confus, mais plutôt à celui qu’elle dévoile sur la terreur de l’époque actuelle : son enlisement dans l'échec politique, notamment.
Pour cette raison, et malgré ses flottements, ses longueurs, ses gratuités, le spectacle reste une belle tentative, et vaut quand même le déplacement.

Notre Terreur
Mise en scène de Sylvain Creuzevault
Avec Samuel Achache, Cyril Anrep, Benoit Carré, Antoine Cegarra, Eric Charon, Sylvain Creuzevault, Pierre Devérines, Vladislav Galard, Lionel Gonzalez, Arthur Igual Léo-Antonin Lutinier
Du 24 novembre au 4 décembre 2009
Célestins de Lyon
06:27 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : notre terreur, théâtre, sylvain creuzevault, d'ores et déjà | 
samedi, 21 novembre 2009
De Gré à Gré
La compagnie Le Chien Jaune présente dans le cadre du Novembre des Canuts une création de Valérie Zipper (écriture et mise en scène). Le contenu de la pièce est extrêmement riche puisqu’il s’agit de raconter au spectateur novice toute l’histoire du Conseil des Prudhommes, né à Lyon le 18 mars 1806 par la volonté de Napoléon, lequel prit bien soin – comme on nous le rappelle avec humour – de réserver un siège de plus aux marchands-fabricants (on dirait à présent les patrons) qu’aux chefs d’ateliers (l’équivalent des ouvriers). L’histoire du Conseil des prudhommes est riche mais complexe, intéressante mais austère et souvent douloureuse : la nécessité d’un tarif remettant en cause le vieux rapport de vente dit « de gré à gré » commença à se faire sentir dans la Fabrique lyonnaise dès le milieu du dix-huitième siècle; dans la foulée de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, les ouvriers tisseurs de Lyon commencèrent donc à réfléchir à une nouvelle façon de vivre et travailler dans la Fabrique : pour structurer le projet, les numéros passionnés et passionnants de l’Echo de la Fabrique, le journal des chefs d’ateliers de 1831 à 1835, que Ludovic Frobert et l’ENS ont heureusement mis en ligne, et auxquels l’écriture de la pièce reste fidèle en en citant de larges extraits. On voit bien l’écueil contre lequel le caractère didactique que ce spectacle revendique aurait pu l’emmener se fracasser, sans l’attention expérimentée de Valérie Zipper au rythme, à la mise en plateau et à la direction d’acteurs.
L’alternance des séquences, tout d’abord, grâce au jeu souvent distancié et souvent contrasté des comediens, qui tour à tour se font employés et employeurs, gens humbles et politiques roués, et donc juges et jugés. Ils nous entrainent l’espace d’un tableau tantôt dans une leçon, tantôt dans un sketch et tantôt dans un mini-drame. Avec une parfaite maitrise : la leçon n'est jamais ennuyeuse, le sketch jamais vulgaire, le drame jamais mélo.
La mise en plateau qui, dès la première image, utilise aussi bien la verticalité que la profondeur et ménage un jeu de théâtre dans le théâtre avec un va-et-vient entre de multiples époques (on se promène ainsi du dix-huitième au vingt-et-unième siècle sans vraiment voir le temps passer).
La direction d’acteurs, enfin, dont le résultat sonne juste. Le dialogue entre les époques ainsi que celui avec la salle sont portés par cinq comédiens qui ne se ménagent pas et déploient la bonne amplitude de registres, du sérieux au comique, au cocasse parfois. Et c’est ainsi que ce spectacle toujours sur le fil réussit son pari ; un pari moliéresque qui fut, en d’autres temps, celui de la fable et de la comédie : plaire et instruire
On souhaite donc à ce spectacle une vie après l’événementiel du novembre des canuts.
De Gré à Gré
Par la Cie du Chien Jaune
Ecriture et mise en scène : Valérie Zipper
Avec Alizée Bingöllü, Cyrille Cagnasso, Emilie Canonge, Denis Déon, Gilles Fisseau
Dernière représentation :
dimanche 22 novembre à 18 heures, salle Paul Garcin (Impasse Flesselles – Lyon 1er)
13:37 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : le chien jaune, de gré à gré, théâtre, valérie zipper, novembre des canuts, conseil des prudhommes | 









