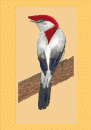mardi, 07 juin 2011
La fortune du peintre
Où s’épuise la fortune du peintre…
Dans un méli-mélo tragi-comique, digne d’un mauvais Zola. Un méli-mélo qui demeure à écrire, et qu’on situerait entre L’Œuvre, La Curée et son Excellence Eugène Rougon. Politique, sexe, gloire et pognon, New-York et la place des Vosges, tous les ingrédients du roman de gare sont réunis et la distribution est presque à jour : Anne Sinclair dans le rôle assez risible de la sainte milliardaire ou de la cocue magnifique, DSK dans celui du politicien libidineux ou de l’affligé repentant, Nafissatou Diallo dans un troisième qui reste à écrire et dont je crains qu’il finisse par être celui du bouc-émissaire. Sans côté la horde des avocats roués, de journalistes à l’affût, du PS en campagne, du téléspectateur blasé…
Le peintre, dans tout ça ? Il fait office d’alibi culturel, d’ancêtre glorieux, de gage de sérieux.

Portrait de Madame Rosenberg et sa fille, daté de 1918. Portrait dans la pure tradition des portraits de cour, un portrait de commande, du peintre à son galeriste. Offert par Anne Sinclair au musée Picasso à l'occasion de son entrée dans le conseil d'administration en 2010.
12:42 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : politique, scandale dsk | 
lundi, 06 juin 2011
En Saint-Denis, Croix-Rousse
Du dehors, l’édifice paye franchement pas de mine. Le clocher qui ouvre sur la rue : Trois fenêtres, un bossage rustique et un petit dôme à lanterne supportant la croix. La façade : rien que beaucoup d’austérité, que perce un unique vitrail, étroit et rond. Il faut franchir le porche, et s’avancer de quelques pas pour rencontrer quelques primes sensations.

Vers 1910
Les Pères Augustins Réformés (qu’on nommait les petits Pères) qui posèrent là la première pierre de l’édifice en avril 1629 sont défuntés depuis lurette. On pénètre alors la pénombre de leur ancienne église conventuelle. Elle n’avait, comme le clocher, rien de remarquable : c’était une nef rectangulaire, couverte d’un simple lambris, et terminée par un modeste chœur. Deux chapelles latérales, l’une dédiée à la Confrérie de la Bonne Mort, l’autre à Notre Dame des Sept Douleurs lui furent adjointes. Au début, les Pères n’étaient guère plus qu’une douzaine en leurs cellules, au milieu des champs, des saules et des vergers, interdits d’aumône par le Consulat, et contraints de donner aux rares habitants du faubourg les sacrements de Baptême, Eucharistie et Pénitence en cas de nécessité.
Autour de leur enclos s’établirent peu à peu d’autres frustes fermes, puis de rustiques hôtelleries pour voyageurs de passage. En ce dix-septième siècle, les chemins alentours n’étaient pas pavés : il y avait celui qui menait vers Bourg (l’actuelle Grande Rue), celui qui partait pour Neuville et l’autre vers Montluel et la Bresse. D’une croix en pierre rose de Couzon, posée à la fin du quinzième siècle, tout le plateau et les coteaux alentours tenaient leur nom.
La Grande Révolution passant par là, l’église conventuelle échappa de peu à la vente des Biens Nationaux et les Augustins disparurent. Avec la fondation de la commune Cuire Croix-Rousse, elle devint paroissiale en 1791 et fut confiée à ancien Augustin du nom de Charles Plagniard, qui devint curé constitutionnel. La Terreur se propageant, la Croix-Rousse s’était proclamée « commune Chalier » et l’église, devenue « temple décadaire », puis « temple de la raison », connut le culte étrange de « l’Etre Suprême ». A son entour, le quartier changeait et se développait de plus en plus vit avec la venue des ouvriers tisseurs. Le 29 Thermidor an VIII (1- mai 1797), la Croix-Rousse devenait une commune autonome et l’église Saint-Denis la paroisse des canuts.
Dans sa pénombre, se découvre un cénotaphe contenant le cœur d’un ancien curé bien aimé de ses paroissiens, Jean Antoine Artru, défunté le 17 mai 1875. C’est l’un de ses prédécesseurs, Claude François Nicod, qui donna à l’église son volume contemporain. Il avait pris la paroisse en 1830, à l’âge de 42 ans, et mourut en 1853. Sur un portrait, on lui découvre un visage long et bon, à la Lamennais. Toute sa vie, il aima le baron de Richemont, alias le duc de Normandie, qui se prétendait Louis XVII, l’enfant du Temple, et avait pris durant leur révolte le parti des canuts (voir ICI son étrange histoire) contre la Garde nationale et les fabriciens. Pour lui, Nicod écrivit en 1850 un ouvrage, L’Avenir prochain de la France, que le Cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, condamna solennellement. C'est, croit-on, ce qui précipita sa fin.
Dès le début de son ministère, le curé Nicod fut soucieux d’obtenir du Conseil Municipal et du Conseil de la Fabrique des fonds pour agrandir l’étroite église des anciens Pères. En supprimant les anciennes chapelles et en aménageant de larges bas cotés, il fit d’abord doubler par l’architecte Antoine Marie Chenavard la nef, puis fit bâtir par Joseph Forest les trois hémicycles du chœur où il disposa les trois autels actuels. Grâce à une souscription, Nicod dota également l’église de ses orgues en 1838. En 1831, bien que légitimiste, cet étonnant curé donna officiellement la sépulture à deux canuts morts pendant les émeutes et cautionna en 1833 un service funèbre à la mémoire des insurgés tués sur les barricades.
C’est un autre curé, Zacharie Paret, qui paracheva son oeuvre en 1876, en confiant au peintre lyonnais Auguste Perrodin la réalisation des trois fresques des voûtes. La vieille église se transformait soudain en une vénérable micro basilique. Ce même Paret, en 1891, redonna vie au culte de Notre-Dame des Sept Douleurs en ouvrant une chapelle qui demeure toujours.
Vous voilà donc dans cette église aujourd’hui. Sur la cuve à cinq pans de la chaire en noyer massif qui sortit au dix-septième siècle des mains d’un sculpteur inconnu, vous reconnaissez des épisodes des Ecritures : La remise des Tables de la Loi sur le mont Sinaï, Jésus marchant sur les eaux, au puits de la Samaritaine, chassant les vendeurs du temple, Saint-Michel terrassant Lucifer. Un peu plus loin, vous voici face à la bannière de la Corporation des Tisseurs de Lyon. Puis à deux reliquaires ; le plus vieux, à deux étages, date probablement des vieux Pères fondateurs. Sur l’autre, est posée une tête de Saint-Denis. Derrière sa façade modeste, Saint-Denis recèle ainsi des trésors d’histoire et de mémoire, au même titre que les grandes églises du centre-ville bien plus visitées, Saint-Nizier, Saint-Bonaventure, Ainay ou la primatiale Saint-Jean. Elle reste le plus souvent ouverte et vaut le détour.
11:08 Publié dans Bouffez du Lyon, Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : saint-denis, croix-rousse, nicod, religion, christianisme, lyon, augustins réformés, rue hénon | 
dimanche, 05 juin 2011
Qui sait ?
Après Benoît et son Artémis, j’accueille aujourd’hui un heureux chantre de la Charente. Certes, les strophes ne sont pas d’une égale mélodie, et quelques alexandrins sont faux. Mais le texte contient l’écho juste et prégnant d’un romantisme à la fois idéaliste et grave, un romantisme que n’aurait pas entachée l’époque actuelle, sa veulerie, ses renoncements. L’homme qui a écrit ces vers a tenu à conserver l’anonymat. Pour paraphraser Vigny et sa Bouteille à la mer, « Il tient dans une main cette vieille campagne » dont il sait le luxe. A vous de l’apprécier :

Qui sait ?
Notre mère avait dit de garder ce refuge
Pour les jours de détresse ou de calamité,
Or personne ne pense au retour du déluge,
Personne n'y croit plus, mais moi je dis « qui sait? »
Lorsque viendront les jours où l'Afrique et l'Asie
Se seront essaimées par nos villes par millions
Et qu'insidieusement, ou bien par tyrannie
Se seront répandues leurs mornes religions,
Paris débordera sur la Beauce et la Brie
Chartres et Tours ne feront qu'une même banlieue
On cherchera en vain à trouver un abri
Regrettant le bon temps que connurent nos aïeux.
Notre Dame, qui sait, aura son minaret,
On refera qui sait, la queue au ravito
Mais à B… l'église gardera son clocher
Les légumes au jardin pousseront à nouveau.
Quand seront épuisées nos sources d'énergie,
Que pour se réchauffer il faudra faire du feu,
L'âtre sera toujours là pour des brûleries
Et l'on fera encore rouler le vélo bleu.
Qui sait s'il s'agit là de vaines conjonctures
Pour des demains lointains et des temps hasardeux...
Mais aujourd'hui déjà, dans sa douce verdure,
Le calme charentais est un luxe fabuleux.
Juillet 2006
09:39 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : poésie, littérature, charente, vigny | 
samedi, 04 juin 2011
L'hulot gaffeur
Le journal le Monde affirme que c’est une boulette. En bonne maîtresse d’école, Eva Joly fait les gros yeux à Nicolas Hulot, l’amateur qui vient d’assurer un peu vite qu’il aurait envisagé un tandem avec Borloo : « Borloo, le meilleur élève de Sarkozy. Il faut en politique, savoir distinguer ses alliés de ses adversaires », renchérit la dame aux yeux bleus et à l’accent scandinave. Le plus drôle vient de Jean-Vincent Placé), disant à propos de Hulot : « C’est un centriste qui n’a aucune culture de gauche »
Là, je dois remercier cet illustre inconnu, qui est, paraît-il, le bras droit de la zézayante Cécile Duflot. Car il me permet de comprendre un peu plus pourquoi, si les gens de droite m’indiffèrent, ceux de gauche m’exaspèrent vraiment. Peut-être parce que cette prétendue culture de gauche, qui exista indéniablement et de quelle façon du temps de la Guerre Froide, est devenue ce salmigondis d’anti-mondialisme, d’anti totalitarisme, d’anti-racisme, d’anti-lepénisme, d’anti-sarkozisme, d’anti-catholicisme, d’anti-nucléaire, bref, un entre-soi qui n'est bâti que de l’anti, mâtiné d’une nostalgie jospiniste ou tontonphile, et de l’idée que tout étant égal à tout, tout se vaut. En gros, dit Placé, il n’a pas notre culture, il n’est pas des nôtres. Voire il n'est pas normal. Que voilà un beau discours de gôche ! Je crois que Hulot n’a pas fini de regretter le bon temps d’Ushuaia !
Ce discours d’une extrême tolérance et d'une intelligence vive, je le reconnais, cela dit, tel que je l’ai vu fleurir au sein de partis ou de syndicats divers, se revendiquant toujours de cette gauche. Il est la raison même de mon désengagement ou si l'on veut de mon contre-engagement.
Comme je l’ai écrit sous l’excellent billet de Nauher (lire ICI) d’aujourd’hui consacré à Marine Le Pen, «Ce qui serait drôle, c'est que le deuxième tour oppose Sarkozy et Le Pen. Imaginez tous les anti-sarkozistes et les gens "normaux" du PS contraints d'aller, après avoir voté Chirac autrefois, voter pour le petit Nicolas. Vrai. Moi qui ne me rends plus non plus dans les bureaux de vote, j'irai ce jour-là rien que pour les prendre en photos ! »

15:37 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : politique, nicolas hulot, eva joly | 
vendredi, 03 juin 2011
Escherichia coli
Une bactérie tueuse, c’est ainsi qu’on commence à la nommer, est en train d’écrire par toute l’Europe un véritable scénario à la Hergé, avec à la clé une psychose dans la population, des milliards d’euros envolés pour des milliers d'exploitants agricoles, et des incidents diplomatiques à rallonge entre Madrid et Berlin d'une part, Moscou et le reste de l’Europe d'autre part, à la suite de l’affaire rocambolesque du concombre masqué. La bactérie mystérieuse porte un nom barbare, qui pourrait tout autant être celui d’une tulipe ou d’une libellule : Escherichia coli.
Ce qui frappe l’esprit, dans cette affaire, c’est la disproportion entre la mort, certes tragique, de quelques individus -pas même encore une vingtaine - et l’inquiétude grandissante des masses, amplifiée de jour en jour par le retentissement médiatique. Même contraste que dans l’affaire DSK, où le drame vécu par deux individus a fini par polluer de façon irrationnelle la conscience de millions d’Occidentaux. Phénomène de la vitesse, de l’anticipation par l’imaginaire, de la contamination ; d’une sorte de vie – et de mort – par procuration ou plutôt par images interposées. La société du crime, écrivit un jour Christian Carle. Une société par laquelle toute perception du Réel à l’échelle individuelle est devenue de plus en plus problématique, tant ce qu'il y a à penser échappe aux limites de la raison individuelle, tandis que les goûts, les peurs, les opinions s’éprouvent et s’expérimentent de manière impérieusement collective et de plus en plus fascisante.
Tel n’est-il pas le sens, non plus, de ces rassemblements festifs, apéro géant à Nantes ou Nuits sonores à Lyon, encouragés par des municipalités complaisantes, qui envahissent l’espace public et privé des individus pour imposer le seul divertissement collectif, lieu d’hébétude alcoolisée où ne s’engendrent là encore que des comportements mimétiques, aliénants, et des modes de pensée collectifs ?
« Les gens de nulle part », les appelaient Philippe Muray, ceux qui « habitent le nouveau monde, ne savent pas où ils vivent, ni ce qu’ils font, et se glorifient de ne pas savoir d’où ils viennent ». Outre-Rhin, et cette information me laisse songeur, des scientifiques se demandent si la bactérie tueuse, celle qui résiste à toutes les antibiotiques, ne provient pas du sol...

07:16 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : escherichia coli, politique, nuits sonores de lyon, philippe muray, dsk, société du crime | 
mercredi, 01 juin 2011
G.T.
Je m’étais depuis longtemps promis de rendre un hommage particulier à G.T., mais le temps filant, sales semaines qui se suivent, j’avais sans cesse remis à plus tard cette espèce de dette accrochée à la filiation. Que de choses demeurent en friches et trouent la barque parmi nos résolutions, parce que tout simplement nous nageons trop vite et trop mal, en gens pressés dans un siècle sans esprit, cloués à la routine tels des chouettes au cœur vide.
G.T. naquit, fils majeur dans une famille de cultivateurs, le 29 octobre 1834. Sur son extrait de naissance, les âges de son père (trente deux ans) et de sa mère (trente quatre). La première fois qu’il a glissé entre mes pattes, je me souviens m’être dit que ça faisait des parents plutôt âgés pour le dix-neuvième siècle et une famille de paysans : leur jeunesse à tous deux, un espace déjà romanesque, ouvert sur son berceau.
L’Ain, en pleine Monarchie de Juillet, campagne profonde d’un pays chrétien où se parle le patois. Les parents de Guillaume, Antoinette et Claude ont reçu juste ce qu’il faut d’instruction pour être à même de signer les registres : leurs signatures vacillantes, balbutiantes, baveuses, de quoi m’émouvoir, oui. Me semble percevoir le bruit de leurs pas, renifler leurs odeurs et comment dire ? Leurs traces, oui, comme les empreintes du gibier qui s’est enfui, sur le registre des mariages de la commune de Thil, ce 3 février 1862-là. Devant un officier du nom de Jean Martin, dans le canton de Montluel, Guillaume T. comparait à la maison commune en compagnie d’Antoinette M., elle aussi cultivatrice et fille de cultivateurs. La lignée. Le sillon. Ils sont des millions par tous les départements, comme ça, à faire un pays. Il a 27 ans, elle 23.
Conformément aux articles 63 et 64 du code Napoléon, suite à un contrat établi par un certain maître Munier, notaire à Miribel, les voilà qu’on déclare unis au nom de la Loi ! Quel effet ça peut faire, d’avoir 27 ou 23 ans en 1862 ! Tellement facile et tellement niais de s’affirmer tous les héritiers d’Arthur, à présent, pauvres modernes de nous passés par les bancs du lycée ! Arthur, c’était qu’un fieffé fou, un cas, comme disait l’entourage de la mère Rimb’, un extravagant, un inconnu. Mais pour les gens du commun qui furent ma souche, avoir 27 ou 23 ans alors, c’était quoi, comment, cet hier déjà si lointain ?
De l’autre côté de l’Atlantique débute la Guerre de Sécession. En Egypte, se perce le canal de Suez. En Prusse, Bismarck est fait ministre de Guillaume Ier, et par cheu nous, Guillaume et Antoinette se marient nom d’un chien ! Imaginer ces ancêtres bilingues ? Pas possible… A s’attarder sur l’épais trait des lettres appliquées de leurs signatures, même fierté de rustres que j’imagine, pourtant, fiers d’avoir su écrire comme d’avoir gagné l’Université à quelques générations de ça. La France, nation civilisée d’après 89. Sûrs d’être modernes, eux déjà.
Républicains ? Peut-être. Dans la suite du registre de l’Etat-civil, le nom de Guillaume presque partout ; toujours lui qu’on cite en témoin, à titre de cousin ou de voisin, sa griffe quatre ou six fois l’an, sous des avis de naissances, de mariages, de décès. A-t-il lu beaucoup de livres ? Nulle assurance. Le journal, j’en ai l’intime conviction. J’imagine ses pantalons gris à rayures épaisses, ses chemises de coton, ses bretelles à boutons. Sans trop me forcer, j’entends comme son rire
Or nous voici déjà en 1867. Une nouvelle fois, sur le parquet rustique de cette maison commune. Guillaume « présente un enfant de sexe masculin ». C’est le 30 décembre. A son domicile est né un garçon qu’on prénomme aussi Guillaume avant d’aller vider les verres. Guillaume II, donc. On vient de passer Noël. Bientôt l’an neuf.
Se joue-là comme un bonheur épais, collectif, rural, calfeutré dans les rouages de la tradition et sûr de son temps. La poursuite de la race. Cultivateurs, leurs maisons basses sont en pisé, leurs champs bordent le Rhône large qui galope vers la ville, leurs rues sont bordées de platanes et leur église, faite de chapelles bancales autour d’un haut clocher, domine le haut mur du cimetière où veillent les Anciens. Entre Lyon et la Suisse, il y a comme du Jean-Jacques dans leur république agricole.
Ils portent noms Guillaume, mais aussi Claude ou Balthazar. Antoinette, Jeanne ou Claudine. 1867 : s’apprête à leur tomber dessus, avant la grande Boucherie de quatorze qui balayera leur monde, comme un avant-propos douloureux, la première guerre du monde moderne. Guillaume qui sait écrire, continue à signer les avis, d’un geste de plus en plus sûr, qui rythme la vie de la commune. Les saisons recouvrent les champs humides non loin du Rhône. Le fleuve offre ses poissons, mais fait aussi pousser l’arthrose. Le pire et le meilleur, toujours. La République de Paris arrive à son pas. La salope leur offrira le meilleur, et le pire tout autant.
C’est Guillaume qui, un tragique soir de janvier 1863, « à une heure du soir », avait signé à 28 ans l’acte de décès de sa mère. C’est lui qui, dix ans plus tard, aura signé celui de son épouse « âgée de trente quatre ans ». Plus tragique encore, et j’entends derrière ces lignes comme un gros chagrin : on vivait en ce temps là dans les champs contigus de la naissance et du deuil, vieillissant, apprenant à survivre.
En 1884, c’est finalement lui qui trépasse, « au domicile de lui-même », déclare l’avis signé par son beau-frère et par l’instituteur, le trente du mois de novembre à six heures du matin. De quoi meurt-on, en ces temps déjà modernes et pourtant rudes, à cinquante ans, au domicile et quand point l’aube ? Suis tenté d’imaginer la thrombose, la thrombose des cultivateurs, et j’espère pour lui qu’elle fut vraiment foudroyante. Il était le grand-père que mon grand-père, né en 1893, n’a jamais connu. Pourtant, que peu d’ans nous séparent !
Je n’ai reçu de lui, ni murs ni papiers ni paroles ni photo. Que des gènes, un vrai parchemin de silence. Sur lequel était inscrit le pire comme le meilleur, l’écriture et la thrombose, un vif émerveillement, aussi, quoi d'autres... allez savoir ? Au cimetière de Thil, nulle trace de sa tombe et sur les registres, le seul roman de sa signature. La dette était là, pourtant, jusqu’à ce jour. Ce genre de chose qu’on sent qu’il faut aussi régler.
Guillaume T, octobre 1834, novembre 1884. Un siècle tout juste avant Orwell.
Dans la France chrétienne d’alors, on composait à la plume des espèces de faire-part en carton plié : « Il n’a pas connu le repos ici-bas. Priez pour lui, en retour, il priera pour vous ».
Voilà. A ce point d'effacement, la prière est telle une dette, et la dette telle une prière : nombreux ceux qui furent, et dont le portrait le plus juste n'est qu'un champ...

20:09 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature, ain, thil, france, état-civil, hérédité |