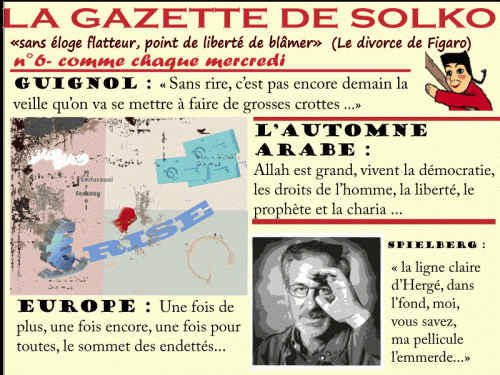lundi, 31 octobre 2011
L'argent des écrivains
"Il y a peu, j’ai reçu un exemplaire du livre fort intéressant et utile de sir Stanley Unwin, La Vérité sur l’édition, qui a été publié à plusieurs reprises depuis 1926 et a récemment été étoffé et remis à jour. Je l’apprécie tout particulièrement parce qu’il rassemble certains chiffres qu’on aurait du mal à trouver ailleurs. Il y a un an ou deux, dans un article pour Tribune concernant le coût de l’imprimé, j’ai essayé de deviner le coût moyen annuel des livres dans ce pays et je l’ai estimé à une livre par personne. Il semblerait que j’avais visé trop haut. Voici les chiffres des dépenses nationales pour 1945 :
Boissons alcooliques : £ 685 millions
Tabac : £ 548 millions
Livres : £ 23 millions
Autrement dit, le citoyen britannique dépense en moyenne environ 2 pence par semaines en livres, alors qu’il dépense presque 10 shillings en boisson et en tabac. Je suppose que ce très noble chiffre de 2 pence doit inclure l’argent dépensé pour les manuels scolaires et pour d’autres livres achetés, pour ainsi dire, par obligation. Comment s’étonner alors que, en réponse à un questionnaire envoyé il y a quelque temps par le magazine Horizon qui demandait à vingt et un poètes et romanciers le meilleur moyen de gagner sa vie pour un écrivain, aucun d’entre eux n’a dit simplement qu’il pourrait la gagner en écrivant des livres ?"
George Orwell
« Combien dépense-t-on pour les livres ? » - 13 décembre 1946 –
A ma Guise, Agone 2008

Orwell
22:13 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : george orwell, a ma guise, littérature | 
dimanche, 30 octobre 2011
Repas de morts
Sur la table littéraire de « cette vieille chienne d’Europe », dans sa chambre « à deux pas du Père-Lachaise », un homme « soulève le couvercle » puis, lentement, mot par mot, en langue française, déguste ses morts. Mère, grand-mère, père, tante, soldats, tous. Ce repas, qui est autant un prétexte à la réminiscence qu’une occasion de se repaître sera sans aucun doute l'une des plus heureuses surprises de cette rentrée.
Repas de morts, le premier roman écrit en français par Dimitri Bortnikov, se déplie à partir d’un centre ambitieux, au cœur-même de l’intelligence de son narrateur, dont ne s’évade que très rarement la conscience de la mort. En quatre parties, le lecteur chausse donc l’esprit finement torturé de Dim, l’immigré déclassé venu des steppes, là où s’ennuya si douloureusement durant des siècles l’âme russe.
L’histoire en arrière-plan, tout d’abord. La lointaine, celle de ces yakoutes « christianisés par force » (p64), de ces cosaques de Pougatchev, maté par Souvorov et Catherine II : « Il sera traquenardé Pougatchev. Dans la steppe – attrapé ». Quand on est trahi – elle est petite la grande steppe… Amené dans une cage auprès de Catherine II, il sera silencieux. Ce sera long… Ils lui couperont les oreilles. Puis les bras. Puis – les jambes. Les yeux dans les yeux ils étaient, comme disent les témoins. Elle n’a pas quitté ses yeux jusqu’à ce qu’il s’éteigne. Il mourra silencieux, cosaque. » (p35). Celle d’Octobre, ensuite, qui l’a, dit-il non sans humour, « laissé dans le rouge» : « Je suis dans le rouge. C’est énervant… Je suis dans la misère. Comme toujours, je cherche un cinquième coin. Quand je pense à mon arrière-grand-mère paternelle … Eudoxie…. Elle avait des domestiques ! Elle se mélangeait pas au peuple… Pas du tout et puis la Révolution ! L’Octobre les a tous touillés : » (p 63)
La sienne ensuite, l’expédition à Tiksi, sur la mer Laptev, « le Styx glacé », la solitude parmi les soldats : « C’est là-bas, au pôle Nord que j’ai commencé à gribouiller… Après tout ça… On a tous vu la mort danser dans la neige… Elle nous invitait un par un. Un après l’autre, voilà encore un, puis encore un autre…Les gars tombaient… S’allongeaient… Tout ça… Si irréel. Je notais leur prénom, simplement les prénoms et puis comment on les avait retrouvés. La mort, j’ai tenu son carnet de bal. » (p111) Et puis Paris, enfin la solitude à nouveau après la séparation d’avec sa femme et son fils, la solitude parmi les citadins : « Droit à rien, je demande rien à personne. Du tout. J’essaie d’exister moins qu’un chat errant (...) Qui je suis, personne. Mais c’est comme ça… En aparté ». (126)
Si un fil conducteur parvient à coudre ces tableaux entre eux, c’est bien toujours la conscience de la mort de celui qui les raconte, et qui sourd de chacun d’entre eux sans qu’on sache si ça fait du mal ou du bien. Elle est si présente dans le cours de son existence que tenter de la fuir, de lui échapper, demeurerait grotesque, et suicidaire. Une telle occasion ne se présente que par instants, fugaces : « J’ai commencé à oublier mes morts. Visage par visage. Malheur par malheur. D’une agonie à l’autre, je les ai tous oubliés. » (p 78). L’amour, alors. Quelques instants de bonheur, de transe. Mais en matière de lucidité, de réalité, le sexe n’arrive jamais à la hauteur de la mort. Le sexe ne nourrit l’être qu’occasionnellement, et ne donne jamais matière à naître : « On était nés on était vivants et – on voulait naître et naître. Là sous le ciel les jambes écartées, gueulant les oreilles bouchées de plaisir – s’oublier et naître. » (p 101)
Mais le sexe n’est pas suffisamment constant pour fonder à soi seul l’objet d’une quête. Tandis que la mort : «Toute la vie on cherche... Quelqu'un. Qui nous vivra après. Qui après notre mort recueillera notre âme. Quelqu'un devant qui t'as pas honte de crever. Quelqu'un à qui tu feras confiance quand il te murmurera - t'es mort. » (p 179) La mort, c'est le point fixe autour duquel s'organise le chaos des réminiscences, le fil conducteur de toute une existence.
Repas de morts est un récit ambitieux, exigeant, ardu, qui possède une véritable gueule sur le plan stylistique J’ai souvent pensé à Céline, le Destouches dernière façon, celui qui d’une exclamation à une autre mêlait les voix de ses hôtes en un même ça, tout en cherchant à coller au plus près d’une parole que le lecteur entendrait, battant une cadence qui s’évaporerait dans ses fameux points de suspension :
Faucon ! O mon fauconnet… Piou… Piou ! Tu m’appelles. Petit oiseau du midi. Mon fauconnet aveuglé… Piou piou il me crie. Sauve-toi ! Cache-toi vite ! Pars dans l’ombre ! Mais il n’y en a pas ! T’es perdu… Perdu… (p 33)
La mort, père… Quel chagrin… Ton fils n’aura pas d’argent pour t’enterrer… Ils murmurent tes copains… Susurrent « Ça roule pas tu vois… Ça coule pas du tout. Ton fils. On le connait bien. Mais pourquoi ? Ah ? Pourquoi… Qu’est-ce qui se passe ? Vit en France lui… Ecrit lui. Des livres ! Et son père ! Meurt seul… Ça colle pas du tout. (p 37)
Par ailleurs, est-ce le statut de solitaire et d’exilé dont jouit à Paris son auteur ? Difficile de ne pas évoquer aussi Beckett, honorant lui aussi de sa vive peine un français langue étrangère, nous invitant sur ses pas à revisiter notre syntaxe.
Comme la lecture de Molloy ou de Malone meurt, la lecture du repas des Morts est une sorte d’épreuve – au sens noble, s’entend. Bortnikov lui aussi parle au présent mythologique. De Beckett, il reprend un certain nombre de thèmes. La solitude, d’abord : «Si t’es pauvre, il faut apprendre les petites choses. Un pauvre doit être léger. Léger… Se contenter de très peu. Il faut être seul. » (p 144).
Une certaine infirmité à être, également. Pour ne pas dire une volonté de ne pas être : « Je me traîne. Suis devenu un pauvre kéké. Je me dis bientôt tu vas partir d’ici. Mais rien n’est bientôt. » (p 161). Comme chez Beckett, une façon de laisser entendre certaines courbes d’un français découvert sur le tard, un français culturel, un soliloque mythologique : « Là je suis seul. Là sur ce pont qui est si léger de tous nos sourires. Seul moi, fils. Lourd moi. Il peut d’effondrer ce pont. Que le soleil parte lui aussi. Que tout parte, Ourson ! Tout ! Pas de force pour sortir les mains des poches. Sauter de ce pont, oui, comme ça, les mains dans les poches. Peut-être tout, toute la vie, ma vie… n’être que la route vers ce pont. Vers ce saut et là tout sera accompli ? Là tout sera fini. Fini pour de bon, fils ? » (p 168)
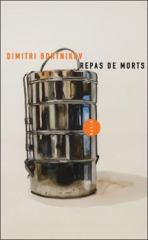 « Ma vie, ma vie, tantôt j’en parle comme d’une chose finie, tantôt comme d’une plaisanterie qui dure encore, et j’ai tort, car elle est finie et elle dure encore, mais par quel temps du verbe exprimer cela ? » se demandait le Molloy de Beckett. « Mon présent n’a plus de survivants », dit Bortnikov, comme si l’absurde avait cessé d’être une expérience individuelle et littéraire, une expérience construite, avait cessé d’être aussi contraignant et abstrait pour adopter les contours du destin de tous, devenir le lot d’un quotidien qui serait lui-même devenu évident : « Ils sont tous morts, les hommes, les femmes de mon enfance. Les chiens aussi. Tous, mon sang. Tous. » (p. 171). Et de conclure, in fine : « Personne ne peut me sauver. Tous ceux que j’aimais devenu nœud coulant pour moi » (182)
« Ma vie, ma vie, tantôt j’en parle comme d’une chose finie, tantôt comme d’une plaisanterie qui dure encore, et j’ai tort, car elle est finie et elle dure encore, mais par quel temps du verbe exprimer cela ? » se demandait le Molloy de Beckett. « Mon présent n’a plus de survivants », dit Bortnikov, comme si l’absurde avait cessé d’être une expérience individuelle et littéraire, une expérience construite, avait cessé d’être aussi contraignant et abstrait pour adopter les contours du destin de tous, devenir le lot d’un quotidien qui serait lui-même devenu évident : « Ils sont tous morts, les hommes, les femmes de mon enfance. Les chiens aussi. Tous, mon sang. Tous. » (p. 171). Et de conclure, in fine : « Personne ne peut me sauver. Tous ceux que j’aimais devenu nœud coulant pour moi » (182)
Il faut déguster lentement ce Repas de morts, au contraire de Beckett, si douloureusement sentimental, et tout comme lui pourtant, si joyeusement expérimental dans le paysage de cette rentrée où tant et tant d’autres écrivains se bousculent et n’ont pourtant à nous raconter que de palotes et convenues intrigues de vivants.
Vidéo réalisée à l'occasion de la publication du Syndrome de Fritz (2002) aux éditions Noir sur Blanc.
Repas de morts, Dimitri Bortnikov, Ed Allia, Août 2011
21:18 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : repas de morts, dimitri bortnikov, allia, littérature | 
mercredi, 26 octobre 2011
La gazette de Solko n°6
00:05 | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : solko, europe, politique, actualité | 
mardi, 25 octobre 2011
L'été 73
Cet été-là, le Qatar était tout juste indépendant
On dînait en Grèce pour 3 francs
Sur des terrasses ensoleillées
Personne n’y songeait tant depuis le franc Poincaré
« L’Allemagne paiera » disaient-ils
Le monde, ses nouvelles, ses bars, ses villes,
Avec du papier que décorait le visage de leurs grands hommes
Les francs se croyaient parés, fournis, et comme
La Fleur aux dents chantait
Joe Dassin qui louchait …
Mon premier job rue Bellecordière
Où les rotatives tournèrent
Pour quelques mois encore
Mon père et ma mère vivaient encore
La nuit dans un bar de cette rue
En lisant des auteurs de leur cru
La chaîne régionale émettait à peine
Du papier, nos poches à tous en étaient pleines
Je guettais l’avenir crissant sur ce papier
La tête emplie d’histoires à raconter
Partir, c’était la sainte Parole de ces temps-là même si
Tout n’était pas si
Entre Cendrars et Nizan
Tranché dans l’esprit des jeunes gens
Partir, loin du pays de nos ainés
Loin aussi du mensonge de mai
Avions-nous senti déjà impavides
A quel point nos poches finiraient vides
Et combien nous ne ferions
D’image en image que tourner en rond
Quand du mensonge de mai sortirait président
La rondeur grise de Mitterrand
Regarde, chanterait naïvement Barbara, puis Le Luron, morose,
L’emmerdant, c’est la rose
Mais nous n’en étions encore qu’à Pompidou
La crise, mais de quoi parliez-vous
Et même durant les années Giscard
La crise, auriez-vous fait un micro-trottoir
C’est pas pour nous auraient chanté en chœur
Des millions de téléspectateurs
Le premier juillet de cette année banale
Rockeller et Brzezinki fondaient la Trilatérale…

papier peint années 70
A suivre
21:20 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : politique, littérature, crise | 
lundi, 24 octobre 2011
Appian, paysagiste.
Adolphe Appian (Jacques Barthélémy) appartient à un temps révolu, celui où l’on naissait dans la rue. Comme le maire Gailleton qui vint au monde sur le pont du Change (depuis démoli), Appian quitta un 23 août 1818 le ventre de sa mère, à l’angle de la rue du Plat et de la place Bellecour. Formé aux Beaux Arts dans la classe de Grobon, il se destina d’abord à la Fabrique et appartint un temps à la fanfare lyonnaise auprès de son ami Joseph Luigini.

Appian ne se consacra réellement à la peinture qu’à partir de 1852, après sa rencontre avec Corot et Daubigny. Il effectua alors de nombreux séjours à Fontainebleau, peignant aux côtés des peintres de Barbizon dont l’influence est sensible dans nombre de ses toiles ; peintre paysagiste et animalier, ses tableaux furent exposés aux salons de Lyon, ainsi qu’aux expositions universelles de Londres (1862) et de Paris (1889). Napoléon III et la princesse Eugénie apprécièrent, dit-on, son œuvre au salon de 1866, ce qui servit sa renommée.

Marais du Roussillon, musée de Macon

Ferme à Cerveyrieux, musée de Tournus

Paysage aux barques
Titulaire de 14 médailles d’or et de 21 médailles d’argent, Appian sut gérer une carrière prolixe grâce à la maîtrise attentive de ses réseaux de distribution : il fut présent au sein de plus de 300 expositions, dans 85 villes différentes. A partir de 1860, sur les pas de Jongkind et Méryon, il « entrera en danse », comme le railla Baudelaire en 1862, pour suivre la mode de l’eau-forte. « C’est vraiment un genre trop personnel et conséquemment trop aristocratique pour enchanter d’autres personnes que les hommes de lettres et les artistes, gens très amoureux de toute personnalité vive », soulignait ce dernier dans son article sur la mode de l'eau-forte. «Non seulement l’eau forte est faite pour glorifier l’individualité de l’artiste, mais il est même impossible à l’artiste de ne pas inscrire sur la planche son individualité la plus intime» Appian, dans ses eaux-fortes, développa son goût pour les paysages, bordures de rivières ou d'étangs :


Appian se fixa quelques années dans le Bugey, puis à Monaco où il se découvrit une vocation tardive de mariniste, et enfin à Collioure, dans les Pyrénées Orientales, où il travailla durant quatre ans.

Pécheurs à Collioure

Vue de Collioure
A partir de 1879, il s’installa à Sainte-Foy-les-Lyons, dans une maison qu’il baptisa «la villa des fusains » tandis qu’on le surnommait « le Delacroix des fusains ». Grand joueur de billard au café du XIXème siècle rue de la République, Appian devint président du jury de la Société lyonnaise des Beaux Arts en 1890, réalisa un grand panneau décoratif pour la préfecture en 1891, reçut la Légion d’honneur en 1892 et fut nommé président d’honneur des sections des Beaux-Arts de l’Exposition universelle de 1894 qui se tint au parc de la Tête d’Or à Lyon.

Paysage fermier
Affecté par la disparition de son fils en 1896, il ne lui survécut que deux ans. Ce dernier, Louis Appian, laissa aussi quelques toiles. Tous deux sont enterrés au cimetière de Loyasse.

Louis Appian, portrait d'enfants

Adolphe Appian, paysage boisé, musée du Louvre
13:32 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : école lyonnaise, adolphe appian, paysagiste, lyon, peinture, eaux-fortes | 
dimanche, 23 octobre 2011
XV de France: quel esprit ?
Mi-temps de la finale France/NouvelleZélande ; tandis que la Société Générale diffuse à nouveau son spot sur l'Esprit d'Equipe :
Marc Lièvremont déclare tout de go à un journaliste dans les vestiaires : "Si on garde cet esprit d'entreprise, ça peut le faire".
Et le commentateur, alors que les Bleus reviennent au score : "Cela prouve l'état d'esprit de l'équipe de France...
Enfin, juste après la courte défaite, François Trinh Duc, au journaliste qui lui demande s'ils ne sont pas "une bande de potes, : "On est vraiment une équipe."
12:16 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : xv de france, trinh duc, all blacks, finale rugby | 
mercredi, 19 octobre 2011
La gazette de Solko n°5
06:18 | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : politique, actualité, solko | 
lundi, 17 octobre 2011
La farce tranquille

Après une parodie de scrutin et une mise en scène médiatique des plus réussies (on aura même eu droit au plan téle suivant la voiture du candidat aux fenêtres fumées, dans la roue de sa Peugeot en direction de l'Elysée la rue de Solférino ), la société du spectacle a élu son nouvel histrion.
Sentiment désagréable de facticité, que tout ceci n'est que postures, imposture, construction d'images, distributions de rôles et ressassement de mots. Une farce tranquille et mystificatrice, qui recommence. A la fin de la pièce, Hollande faisant applaudir les candidats malheureux, comme après une représentation. Scénographie d'énarques bien huilée, bien rodée, maçonnée en loges. Dans tout ça, comme d'hab', un grand absent dont on parle sans cesse, pourtant : le peuple.

05:54 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (22) | Tags : politique, hollande, parti socialiste | 
dimanche, 16 octobre 2011
La grâce d'une cathédrale
Après Reims et Strasbourg et avant Rouen, Amiens, Paris et Chartres, les éditions La Nuée Bleue sortent un ouvrage monumental sur la primatiale Saint Jean de Lyon. Cette parution vient heureusement combler un vide éditorial, au moment même où une dernière opération de ravalement vient de rendre à la vue de tous la façade du XVème siècle de la plus vieille église de France, qui encore aujourd’hui vaut à son évêque le titre de primat des Gaules. La Grâce d’une cathédrale, qui ambitionne de devenir l’ouvrage de référence, regroupe trente-six auteurs parmi les spécialistes de l’édifice sacré, architectes, historiens, tailleurs de pierre, théologies, archéologues. Il est certain qu’au vu de l’Histoire, la cathédrale actuelle, vestige d'un palais épiscopal qui fut si souvent pillé, saccagé, en partie détruit, avait besoin d’être ainsi mis en valeur, la riche histoire dont elle témoigne mise en lumière : en trois parties, « l’aventure de sa construction », « la description de l’édifice » et « l’histoire de la vie civile et religieuse au cours des siècles », il s’est donné les moyens de séduire un public très large, du touriste intrigué à l’érudit passionné. J’ai toujours beaucoup aimé la justesse rêveuse de la dédicace qu’en fit Sidoine Apollinaire au Vème siècle, dans laquelle s’exprime un ressenti à la fois limpide et précis du site lui-même, élevé dans le court espace qui sépare la Saône du mont Fourvière :
« L’édifice élevé brille et n’est déporté ni vers la gauche ni vers la droite, mais par le sommet de son fronton, il regarde le lever du soleil à l’équinoxe. A l’intérieur, la lumière scintille et le soleil est si bien attiré vers le plafond à caissons couvert de feuilles d’or qu’il musarde sur le métal fauve dans un même concert de couleurs. Le marbre, qui se moire d’une variété d’éclats, garnit dans son entier la voûte, le sol, les fenêtres et, sous les figures aux couleurs changeantes, un vert revêtement printanier fait s’incliner grâce à des tiges de vert émeraude des tesselles de saphir. A cet édifice s’appuie un triple portique, orgueilleux de ses supports en marbre d’Aquitaine ; à son imitation, une seconde série de portiques ferme un atrium plus lointain et une forêt de pierre couvre un espace médian, de ses colonnes placées plus loin. Ici la colline résonne, là la Saône renvoie l’écho ; d’un côté se réfléchit le bruit du piéton, du cavalier et du conducteur de chars grinçants, de l’autre le chœur des rameurs courbés élève vers le Christ le chant rythmé de la rivière, tandis que les rives répondent en écho Alléluia. Chante, chante ainsi, matelot ou voyageur, car c’est ici le lieu où tous doivent se rendre, le lieu où se trouve la route qui mène au salut ».
Certes les vaguelettes de la Saône ne lèchent plus le chevet de la vieille église, le palais épiscopal fut en parti détruit, et les niches de la façade demeurent, depuis le passage du baron des Adrets, vides d’images. C’est justement ce qui rend ce genre de publication indispensable : un livre dont les 500 pages et les 600 illustrations feront date.

Lyon Primatiale des Gaules, La grâce d’une cathédrale, Ed. La Nuée Bleue, à suivre sur ce LIEN

Statue de Jean Baptiste
11:52 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : lyon, littérature, la grâce d'une cathédrale, la nuée bleue, primatiale saint-jean |