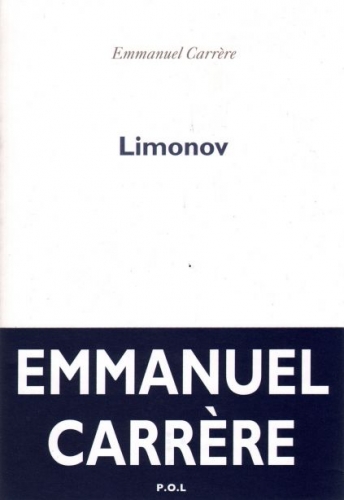mercredi, 09 novembre 2011
La gazette de Solko n°8
05:59 | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : grèce, papandréou, papademos, berlusconi, assemblée nationale, iran, politique, solko, actualités | 
mardi, 08 novembre 2011
L'Année du premier pas
D’un côté de la toile, il y avait la maison paternelle. La ferme où fut ravie l’enfance. Belle affaire que l’enfance ravie ! Et dans un corps vigoureux, il s’élance. Tout autour bruissent les grillons d’un seizième été. Lieu d’où s’annonce le monde.
De l’autre côté de la toile, le monde, précisément. Le monde qui court là-bas, de reptile en reptile, jusqu’aux plus renommées capitales. L’enfance enfin ravie, merci ! Il ira pieds nus par les routes et gagnera sa vie.
D’abord, précisément, ce champ d’andains à traverser; l’or de ces blés fauchés, de la couleur des saints ! Une technique pour traverser sans dommage, n’y poser le pied que le temps vif du rebond. Plisser le front sous la cisaille et contre le flanc, serrer le poing. Car après ce champ surgiront d’autres. Du même effort, et de la même couleur après chaque haie, chaque ville, guère plus qu’un pas.

Ce vert marin le tire, que déplacent les illusions lumineuses : cet été déjà tendu vers l’hiver : qui a quitté l’enfance a quitté pour jamais son été. Il apprendra cela de la déception de Venise, de Patmos, d’Istanbul, et d'ailleurs. A présent, devant cette toile de Ravier, lui importe seul de nicher à nouveau au seuil de cet instant superbe où il ne savait rien du désenchantement, l’année du premier pas.
Toile d'Auguste Ravier, Paysage au couchant
06:25 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : peinture, littérature, ravier, poème | 
lundi, 07 novembre 2011
Rentrée de novembre
«Les enseignants qui prennent le plus de place dans mes souvenirs sont ceux qui créaient une tension extrême, par conséquent les originaux, les extravertis, ceux qui étaient hauts en couleurs. Certes ils n'étaient pas majoritaires, mais ils étaient nombreux. Il y avait, chez certains d'entre eux, un côté tragique que nous ne pouvions que deviner. Un état de désespoir qu'on pouvait définir ainsi : je sais que tous les adorables crétins que j'ai devant moi ne m'aimeront jamais, je sais qu'ils ne peuvent m'aimer, mais je vais au moins faire tout mon possible pour qu'ils ne m'oublient pas.»
Tomas Tranströmer, Les souvenirs m'observent, Castor Astral p 59
Je crois n'avoir jamais aimé ce mot enseignant. Peut-être est-ce l'homophonie qu'il suggère, peut-être aussi cette manière qu'il a de placer l'accent non pas sur un quelconque contenu culturel, mais sur une activité commune, ordinaire... Depuis les réformes conduites par la gauche socialiste lorsqu'elle était aux affaires, un enseignant, au contraire du mythe qu'on sent encore posé chez Tomas Tranströmer, c'est une sorte de postier cultivé qui occupe (et parfois éduque) les gosses des autres, pendant, que ces derniers travaillent. En banlieue, sa mission fondamentale demeure, comme celle des flics (profs, onomatopée résonnant comme flics), de maintenir une sorte de paix civile. En centre ville, l'enseignant ressemble plus à une vitrine, dont le rôle est de garantir les illusions des classes moyennes de plus en plus anxieuses.
Beaucoup de lieux communs galopent vertement à propos de cette profession. Cela va de la version privilégiés voire nantis (garantie d'emplois, vacances scolaires alignés - mais pas payés - sur ceux des élèves) à la version sinistrés (ils sont en souffrance, on ne les comprend pas, etc, etc). A bien les condidérer, ce sont pourtant des gens fort ordinaires, d'anciens bons élèves n'ayant jamais vraiment quitté l'école et donc le plus souvent complètement déconnectés du milieu de l'entreprise, bien plus encore de celui de la débrouille ou de la rue. Tenus, par une sorte de morale assez désuète, à ne pas trop afficher leur goût pour l'argent, toujours soucieux d'exalter la gratuité de l'effort et l'élégance du sacerdoce, en causant intérêt de l' élève à propos de tout et de n'importe quoi ; et par une tradition venue d'on ne sait quel républicanisme d'avant-guerre passé par 68 et 81 et mal digéré, résignés à voter à gauche même quand elle n'est plus du tout de gauche. Drôle de corporation. Tous très attachés à des cultes dénués de sens, comme celui de l'égalitarisme appliqué à toutes les sauces, à des rites inutiles, comme celui de finir les programmes même si personne ne sait prendre la moindre note dans l'assemblée à laquelle ils s'adressent. Tous, persuadés que leur parole compte, au moins dans le pré carré de leur classe.
Les enseignants partagent avec leurs élèves un même espace public, devenu au fil du temps de moins en moins studieux et de plus en plus ludique, réglé, où qu'on se rende dans l'Hexagone, par la convention d'une esthétique d'Etat assez chiche, mais qu'importe ! Les établissements scolaires qui sont pour les elèves des lieux de passage, à l'image des couloirs de métro ou des halls de gare, demeurent pour eux leur territoire. Imaginez vous en train de hausser le ton dans une salle des pas perdus pour parler à un groupe de gens qui seraient là de physique quantique, de morale abstraite, de la guerre du Péloponèse. C"est un peu ce sentiment d'absurdité qu'ils ressentent, et qui confère ce teint maussade, gris et orgueilleux à leur irréparable solitude, quand ils attendent le bus à quelques pas de grappes d'ados boutonneux et bruyants.
Pour moi, aucun défilé - pas même de militaires ou de majorettes - n'est plus pathétique qu'une manifestation d'enseignants. C'est la raison pour laquelle, depuis pas mal d'années, on ne m'y voit plus. Ces monômes rythmées par des chansons de colonies de vacances et des revendications toujours identiques, quelles que soient les réformes, eurent pourtant une fonction respectable puisqu'ils se rattachent - au moins symboliquement - à la tradition hugolienne des manifestations de rues. Mais quelle mascarade, quelle raillerie ! Quel écart, loin de la barricade ! Et quel puéril aveu d'impuissance lorsqu'au coup de sifflet syndical, chacun regagne sa porte, de chaque côté du long couloir gris, pour y faire rentrer ses élèves, comme après une bonne cuite et un super karaoké les touristes aux cheveux grisonnants rassemblés par les organisateurs du tour operator se dirigent vers la chambre d'hôtel.
Il est finalement assez juste de dire que la plus belle part du métier réside dans le contact avec les élèves. J'ai placé le terme en italiques, parce qu'il ne signifie plus grand chose à force d'être utilisé, version soft de ce qu'on nomme aussi face à face pédagogique. Non que les élèves soient plus exceptionnels que n'importe quel autre groupe humain (on y retrouve le même fourre-tout qu'ailleurs, en moins civil, moins éduqué), mais se joue dans ce contact ce qui fonde la raison d'être de l'enseignant comme d'ailleurs celle de l'élève, ce qui justifie leur présence à tous. Un résidu de raison. Ce contact qui est fait de spectaculaire, de conventions, d'ennui, de spontanéité, de craintes et d'envies réciproques, structure de semaines en semaines l'emploi du temps de millions de gens derrière les façades des écoles. Il rythme le calendrier de tout un pays, la consommation comme le moral des ménages, le passage d'un âge de la vie à un autre, garantissant la morne paix civile, comme je l'évoquais plus haut, et laissant croire à la vivacité des derniers feux culturels d'une civilisation endettée jusqu'au cou, et pourtant contrainte de survivre à sa mortalité, malgré Paul Valéry.
05:49 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : actualité, paul valéry, civilisations mortelles, tomas tranströmer, rentrée scolaire, littérature | 
dimanche, 06 novembre 2011
Les écrivains au carrefour des lieux communs
Dans le lourd pavé qu’il consacra à James Joyce en 1959, Richard Ellmann rappelle ce conseil que prodiguait le vieux maître (qui, par ailleurs, disait de lui-même : « Je ne suis qu’un clown irlandais, un plaisantin universel ») : « si tu entends un lieu commun, fuis immédiatement» Avec sept milliards d’individus sur Terre, le programme est de plus en plus ardu à réaliser, mais abrite toujours une épée de sagesse pour qui comprend l’individu comme un original, dans le sens premier du terme : si durant son dur labeur, l’écrivain doit faire de la copie, il convient si possible qu’il évite d’en devenir une lui-même. Rude besogne qui a de quoi l’occuper, il est vrai, jusqu’à sa mort. Joyce, qui se flattait déjà auprès de Beckett que personne, hormis quelques Juifs, n’ait lu Ulysse en entier, a si bien réussi son programme qu’il a fini par écrire ceci : « Non, ayde-moi Pétault, ce n’est pas une malléfficace pourqhyacinthine orgie de taches et macules et barres et boucles et cercles et grouillons et notules juxtaposées que relient des giclées de vitesse. Veut seulement dire je l’aime ou je l’enquiquinne… »
Finnegans Wake fascine parce que c’est un vrai lieu, habitat de papier circulant de par le monde, et qu’on sent lisible de son auteur seul ; c’est au fond la transcription narrative la plus achevée de ce conseil offert un jour et devenu méthode : fuir le lieu commun. « J’ai découvert, disait Joyce, que je peux faire avec le langage tout ce que je désire » ( Entretiens avec Samuel Beckett, 1954)
Le lieu commun, l’écrivain inquiet d’y noyer son pauvre esprit peut aussi tenter pour le mettre à distance d’en dresser l’exégèse, comme y excella en son temps Léon Bloy. «Car il est temps de le déclarer, la langue des Lieux Communs, la plus étonnante des langues, a cette particularité merveilleuse de dire toujours la même chose, comme celle des Prophètes. Les bourgeois, dont cette langue est le privilège, n'ayant à leur service qu'un très petit nombre d'idées, ainsi qu'il appartient à des sages qui ont réduit au minimum le fonctionnement de l'intellect, rencontrent nécessairement chacune d'elles à tous les entrecroisements de leur quinconce, à chaque tournant de leur bobine. Je plains ceux qui ne sentiraient pas la beauté de ça. Quand une bourgeoise dit, par exemple : «Je ne vis pas dans les nuages », tenez pour sûr que cela veut tout dire, que cela dit tout et qu'elle a tout dit, absolument et pour toujours. («tout le monde ne peut pas être riche», p 35 dans l’édition numérisée ICI) Je me rends compte à l’instant que Léon Bloy écrivait cette exégèse il y a tout juste 110 ans, or voyez comme cela demeure actuel : «Être comme il faut : Règle sans exception. Les hommes dont il ne faut pas ne peuvent jamais être comme il faut. Par conséquent, exclusion, élimination immédiate et sans passedroit de tous les gens supérieurs. Un homme comme il faut doit être, avant tout, un homme comme tout le monde. Plus on est semblable à tout le monde, plus on est comme il faut. C'est le sacre de la Multitude»
Une autre façon d’empoigner le lieu commun, plus balzacienne, traverse jusqu'à nos jours toute la littérature dite réaliste : il faut se rappeler que le point de départ de la Comédie Humaine, tel que son auteur l’explicite dans l’Avant Propos, est une comparaison entre l’humanité et l’animalité. Depuis les Caractères et l’avènement de la physiognomonie, une tradition classique avait fait en effet du personnage un pur lieu commun, celui où le plus grand nombre vient, au fil de sa lecture, reconnaître ses vices ou rêver sa vertu. Ses sentiments eux-mêmes, note Balzac dans La Recherche de l’Absolu « gardent la physionomie des lieux où ils sont nés et l’empreinte des idées qui ont influé sur leurs développements.» D’une certaine façon, le personnage balzacien réussi se doit de n’être que l’incarnation indiscutable d’un lieu commun, qu’il devînt « Napoléon de la finance » ou « Christ de la Paternité ». Dans cette perspective, le grand art n’était pas de le fuir ou d’en dresser l’exégèse, mais de le figurer au sens propre, et de la manière la plus tranchée et la plus performative qui soit, telle une formule magique et indiscutable : « Les ambitieux ont les reins plus forts, le sang plus riche en fer, le cœur plus chaud que ceux des autres hommes (Le Père Goriot) « Une famille qui n’est plus rien pour personne en France serait un sujet de moquerie à Paris. Elle est toute la Bretagne à Guérande (Béatrix) ; « Voilà les Parisiennes : si elles ne savent pas se vendre, elles éventreraient leurs mères pour pouvoir briller » (Le Père Goriot) ; « Tuer la fortune d’un homme, c’est pire que le tuer lui-même » (Sarrasine), « La vie est en nous et non au-dehors » (Louis Lambert) ; « Nous nous aimons en raison du plus ou moins de ciel que contiennent nos âmes » (Séraphita) ; « il y a quelque chose de plus fort que nos sentiments, c’est la Nature » (La cousine Bette)… Impossible de lire Balzac et de l’aimer sans presque voir le sourire de ces lieux communs, sourire qui est à la fois celui de l’homme pressé, de l’écrivain payé à la ligne et de l’artiste qui voulut un jour rivaliser avec l’Etat-Civil...

13:03 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, james joyce, léon bloy, balzac, finnegans wake, éxégèse des lieux communs | 
vendredi, 04 novembre 2011
Il y a Limonov et Limonov
Qu’est-ce que le fils d’Hélène Carrère d’Encausse trouve donc à Limonov ? Ce que le bourgeois qui allait à la Belle Epoque s’encanailler chez Bruant, ou celui des années soixante qui bouquinait du Genet dans les chiottes devait trouver aussi : une sorte d’encrapulement mental assez malsain, d’excitation sordide à s’imaginer autrement qu’en héritier confortablement installé, une façon de jeter en imaginaire de véhéments défis à cette loi du milieu dont on sait, par ailleurs, qu’on ne pourra que la suivre, la suivre et la suivre encore jusqu’au Renaudot faute de mieux… Faute de mieux, puisque la deuxième sélection du Goncourt l’a bouté, Emmanuel, à cause de ce Limonov galeux, toujours aussi infréquentable : « mais qu’est-ce qu’Emmanuel est allé faire dans cette galère », susurra Didier Decoin. Et les gens de chez Drouot, pour punir le rejeton d’être allé s’enticher de cette « sale bête » couronnèrent Jenni et son roman (aussi sage que lointain de Paris) sur la décolonisation, qui ne casse pas trois pattes à un canard mais au moins ne mange pas de pain
J’étais cet après midi dans un Centre de distribution d’objets culturels indéterminés, à laisser vaquer mon œil dans ce naufragé du Goncourt échoué chez Théophraste. « J’ai du mal à choisir entre deux versions de ce romanesque : le terrorisme et le réseau de résistance. Carlos et Jean Moulin. » Bon. Le dilemme d’Emmanuel Carrère vaut-il celui de Rodrigue, je ne sais, mais je commence à m’ennuyer. Pourquoi appelle-t-on cela un roman ? Autrefois, on disait biographie. Et on attendait la mort des gens avant de les encercueiller ainsi dans de graves caisses en papier.
Après l’autofiction, voici donc l’ère de la biofiction, au ton aussi chiche que chic, puisqu’on l’insinue, cette bio, romancée. Mais toute bio ne l’est-elle pas, maquillée en roman ? C’est même me laissais-je dire depuis toujours ce qui fait l’intérêt des biographies, enfin passons. Et puis, qu’en sais-je, moi, pauvre lecteur provincial, si ce que Carrère raconte pages 52, 126 et 316 s’est bien passé ou non ?
Le narrateur déclare qu’à propos de son héros, salaud ou héros, « il a suspendu son jugement » S’il a suspendu son jugement, on peut aussi suspendre le nôtre, mais alors à quoi bon lire ce livre qui n’est au fond guère plus qu’un long reportage, ou un long article, à votre guise, du Nouvel Obs.
Oui, à quoi bon ce livre ?
Edward Limonov (le vrai) a atteint la moyenne d’âge des écrivains français (entre 60 et 65 ans), cette moyenne qu’il dénonçait en 1986 dans sa nouvelle, Salade niçoise. Il est devenu respectable à son tour, une version russe de tous ces « pépés et mémés », à qui (je continue à le citer) « appartient le papier». Emmanuel Carrère avoue dans l’un de ses chapitres l’avoir découvert dans les affaires de sa mère, grâce à un exemplaire dédicacé du Poète russe préfère les grands nègres. Il aurait alors ressenti une véritable jalousie de plume à la lecture des lignes du démon qui savait, lui, écrire le Réel. Cette fascination, toujours, du fils à papa inhibé par sa maman, devant le mauvais garçon qui vit lui sa libido au grand air. C’est bien connu, rien ne plait plus au bourgeois que d’être traité de pisse-froid ou d’impuissant par le prolo. La ritournelle existait déjà au temps de Bruant. Suffisant pour faire un livre aujourd’hui ? Apparemment, oui, aux dires de la critique. Pourtant, Carrère n’a pas de plume, et Limonov, le démon qu’il aurait aimé être, en a peu aussi : tiens, petit exercice, lequel a écrit cette phrase, et lequel cette autre, et, de celle produite par l’original et de celle produite par la copie, laquelle est la meilleure ?
« Kasparov devient une sorte de François Bayrou »
« Le capitaliste Bernard Tapie ressemble à Simone Signoret jeune »
18:28 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : emmanuel carrère, limonov, prix renaudot, littérature, actualité | 
jeudi, 03 novembre 2011
Jenni et l'art français du roman
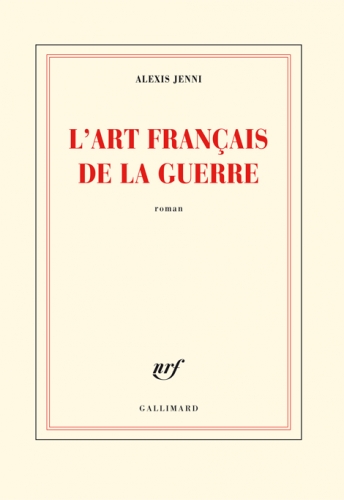
Comme il y eut un art français de la guerre, il y eut un art français du roman. C’était au temps où télévisions, ordinateurs et radios n’occupaient pas toute la place, le temps des grandes fresques héroïques, chroniques historiques et romans à thèses des années trente. C’est vers cet art que le pavé de plus de six cents pages d’Alexis Jenni tente, avec autant de bonheur que de malheur, de revenir.
Bonheur, parce qu’une telle entreprise rompt de façon radicale avec l’autofiction narcissique et les récits convenus du moi je de la culture du narcissisme, tels que les définit Christopher Lasch dans un chapitre désormais fameux sur le déclin du sens historique : «Vivre dans l’instant est la passion dominante –vivre pour soi-même et non pas pour ses ancêtres ou la postérité. Nous sommes en train de perdre le sens de la continuité historique, le sens d’appartenir à une succession de générations qui, nées dans le passé, s’étendent vers le futur » (1)
En recherchant le fil de cette continuité historique éclipsée qui conduisit le pays d’une guerre à l’autre, des monuments de 14 aux tortures d’Algérie, L’Art français de la guerre veut réfléchir, construire « un miroir » (p 583) dans lequel scruter notre façon de vivre ensemble en République. Mais chercher à saisir à travers le prisme d’un seul personnage (Victorien Salagnon) la complexité d’une cinquantaine d’années d’histoire, privilégier à ce point le regard d’un seul, n’est-ce pas prendre le risque d’en faire un donneur de leçons et d'aboutir à une extrême simplification du propos ? Prendre le parti d’une narration somme toute chronologique qui s’étale sur treize chapitres (6 de romans, 7 de commentaires), n’est-ce pas céder plus à la démonstration qu’à la dramatisation ? In fine, cette volonté de revenir à un discours qui serait collectif s’enlise trop souvent dans la répétition et le lieu commun pour réellement captiver son lecteur.
L’Art français de la guerre s’écrit à la croisée de deux personnages, le premier devenant l’héritier, (pour ne pas dire le fils spirituel) du second : deux existences, celle du narrateur à partir de 1991, celle de son héros principal à partir de 1943 s’y récitent, toutes deux façonnées par les morsures successives de l’Histoire :
La crise pour le premier qui, malgré son appartenance à cette « classe moyenne éduquée, volontairement aveugle aux différences » (p 245), occupée à pousser son charriot le samedi à l’hypermarché « dans une foule d’autres couples joliment vêtus »(p 115), ne parvient plus à assurer, au sens traditionnel du terme, une quelconque stabilité psychologique à son existence dans le chaos postmoderne. La crise l’a plongé de dérive en dérive dans « un état social désagrégé » (p 490) : « Quand l’homme perd son travail et n’en retrouve pas, on lui prend sa maison et sa femme le quitte » (p 111) ; aussi devient-il, ce narrateur, une sorte d’épave d’Epinal occupée à hanter les bistrots et tout juste bonne à écrire des romans : « J’exerçais mon parasitisme avec un bonnet sur la tête » (p 31) « quand j’émergeais de mes siestes éthyliques, je lisais des livres, je voyais des films » (p 36) « La dégradation sociale mène à la solitude » (p 491)…
La guerre pour le second qui, de la Résistance aux guerres coloniales, a forgé son destin de paria militaire et de peintre du dimanche : « Les gens sont leur environnement », écrit Jenni p 217. C’est un retour, au sens le plus romantique du terme, au personnage historique : celui dont le physique, la psychologie, la cohérence narrative dépendent entièrement du moment du pays dans lequel il est inscrits, et dans lequel se joue le destin national : l’Occupation Allemande, les guerres d’Indochine puis d’Algérie, la 1ère République de Gauche et « son Leviathan doux, embarrassé par sa taille et son âge » (p 111 et 194), l’hexagone d’aujourd’hui et son communautarisme libéral : « Nous mourons à petits feux de ne plus vouloir vivre ensemble » (p 483).
La deuxième caractéristique de ce que Gaétan Picon appelait « le roman traditionnel » (2), et dont Jenni cherche à réactiver la formule, c’est le déploiement de grands thèmes humanistes.
Le principal, c’est évidemment la guerre. Il surgit habilement du désœuvrement du narrateur, lequel rencontre dans un bar de la banlieue de l’Est lyonnais « un homme au journal qui occupe toute la place, un ancien d’Indochine. Et là-bas, il en a fait, des trucs… » (p 33). A la faveur d’un dimanche au marché aux Artistes des bords de Saône, tous deux se découvrent un point commun : l’un narre, l’autre peint. Un deal s’opère, une sorte d’échange : le plus vieux apprendra à peindre au plus jeune qui remettra en forme le récit de ses exploits guerriers d’un autre siècle (« je suis le narrateur, il faut bien que je narre »-p 51).
C’est ainsi que la matière du roman parvient jusqu’au lecteur comme une pièce oubliée, une chambre obscure (p 46) : ce seront ces guerres qui se succédèrent durant vingt ans, et « chacune épongeant la précédente, les assassins de chacune disparaissant dans la suivante » (p 471) ont fractionné pays ; ce sera la lente décomposition de la tradition militaire de l’armée française, saisie à travers le regard d’un soldat quelque peu excentrique (excentrée) puisqu’également peintre. Ce sera la « pourriture coloniale » qui « nous infecte, nous ronge, revient à la surface » (p 191)
De page en page et malgré le final assez lourdement allégorique du roman (Faites l’amour, pas la guerre), Jenni confirme le fait que la guerre, comme le souligna astucieusement La Bruyère, « a pour elle l’Antiquité ». D’une part parce qu’elle parait conforme à la nature humaine, car si « l’art de la guerre ne change pas » (p 255), c’est que l’obéissance est une vertu naturelle de l’humanité : « En suivant les principes de l’art de la guerre, je peux faire manœuvrer tout le monde comme à la guerre » (p 63). « Tu sais pourquoi la guerre est éternelle ? Parce qu’elle est la forme la plus simple de la réalité. Tout le monde veut la guerre, pour simplifier » (p 322).
Il arrive heureusement que la guerre croise des causes justes, en l’occurrence les grands mythes, eux aussi éternels, de la Résistance ou de la Libération. C’est par ces causes ambigües qu’on entre dans la guerre. C’est alors pour ne plus en sortir : « Vous faites la guerre. Je fais la guerre. Peut-on faire autre chose quand on a appris ça ? (p 427). Cependant, «la guerre change » (p 504) : Il arrive que d’une guerre à l’autre, le héros du Bien (la Résistance contre les Allemands) se métamorphose en un héros du Mal (la torture sur les Algériens) « Pour se battre, on sait faire. Pour ce qui est du pourquoi, j’espère qu’à Paris, ils savent » (p 431). « Ordre et contrordre, marche et contremarche, c’est la routine militaire » (571). C’est alors que la sécheresse de son art apparaît comme un crime.
Demeure malgré tout le risque du mensonge intrinsèque à tout récit de guerre, puisque pour parler d’elle, on ne dispose que de survivants triés par le hasard : «Survivre, c’est prendre la bonne décision, un peu au hasard, et cela demande d’être tendu comme une corde. Sans cette tension, le hasard est moins favorable. » (p 421) Or « les survivants d’une fuite peuvent être décorés comme des vainqueurs » (p 427) : ainsi, la guerre appartient au domaine de l’histoire souvent contrefaite, pas à celui de la vérité. Et le récit de guerre n’est qu’une feinte : « On croit à les entendre que l’on peut s’en sortir, qu’une providence vous protège et qu’on voit la mort du dehors s’abattre sur les autres. On en arrive à croire que mourir est un accident rare » (p 455). « Je suis las de cette immortalité, confie le héros fatigué. Je commence à trouver cette solitude pesante. » (p 456)
De ce premier thème en découle un deuxième qui touche l’actualité : l’identité française dans la France postcoloniale (« Le corps social tremble de mauvaise fièvre » – p 172 ; « La situation en France est tendue » - p 173). Dans « le chaudron urbain qui mijote » (p 606) l’identité des hommes a beau ne pas se dire, mais se croire, se faire, voire se regretter (p 616), en digne héritier de De Gaulle, Janni ne cesse d’affirmer qu’elle se définit par la langue qu’ils parlent : « La langue nous comprend, et c’est elle qui dit ce que nous sommes ». « La seule langue qui vaille est celle que l’on comprend avant de réfléchir » (p 37), voilà pourquoi « La France est l’espace de la pratique du français » (155 « La France est l’usage du français » (197), « la langue de l’Empire des idées », c’est pourquoi « la France est la terre d’accueil de tous les inexistants » (p 228).
S'ensuit une interrogation récurrente sur l’usage et la signification du pronom nous pour définir celui qui est français et celui qui ne l’est pas : « nous est performatif, nous à sa seule prononciation crée un groupe » (p 36) : Mais « personne n’est d’accord sur ce que nous veut dire » (p 277 ) et « l’on peut jouer des pronoms sans jamais rien préciser » (p 194) « Nous se définit par eux ; sans eux nous ne sommes pas. Eux se constituent grâce à nous ; sans nous, ils ne seraient pas » (p 567) Mais jouant de quel groupe, jouant de quelle ressemblance, c’est-à-dire de quelle race ?
D’où également cette insistance à voir en De Gaulle essentiellement un bâtisseur de fiction, un Romancier à l’image du César antique dont le jeune héros traduisait des passages sous l’Occupation (« César par le verbe créait la fiction d’une Gaule qu’il définissait et conquérait d’une même phrase, du même geste. César mentait comme mentent les historiens, décrivant par choix la réalité qui leur semble la meilleure » (p 59. De façon comparable, De Gaulle, « écrivain militaire » (p 556) exista avant tout par la langue et par le verbe : « Qui, sinon De Gaulle, peut dire sans rire qu’il pense à la France ? De Gaulle est le plus grand menteur de tous les temps, mais menteur il l’était comme mentent les romanciers. Il construisit par la force de son verbe, pièce à pièce, tout ce dont nous avions besoin pour habiter le XXè siècle (…) La France est le culte du livre Nous vécûmes entre les pages des Mémoires du Général, dans un décor de papier qu’il écrivit de sa main ». (p 161) « De Gaulle satisfait à lui tout seul notre goût de l’héroïsme » (p 481). « Il avait du souffle, le grand général sans soldats qui manœuvrait les mots, il avait le souffle romanesque » (p 556). Fonder l'ordre national, c'est donc fonder le verbe. Résister, donc c'est maîtriser le discours. L'art français de la guerre rejoindrait-il, ici, l'art français du roman ? Au risque de l'Histoire ? «Nous nous sommes mis hors l’Histoire en suivant les sages préceptes du Romancier. » (p 617)
Le dernier des grands thèmes abordés serait la représentation du Réel, qui ne s’envisage et ne se considère ici que sur le mode du figuratif. Narrer, peindre : « Il y a plein de débuts dans une mémoire (…) Vous pouvez vous faire naître quand vous voulez. On naît à tout âge dans les livres », assure le narrateur (p 51), et le peintre : «Tout peut faire sujet. Les Chinois peignent depuis des siècles les mêmes rochers qui n’existent pas, la même eau qui tombe sans être de l’eau, les quatre mêmes plantes qui ne sont que des signes ; la vie de la peinture est non pas le sujet mais la trace de ce que vit le pinceau ».(p 406). Comme l’écriture est l’art de la formule, le dessin serait donc cet art du trait devant la réalité, un art simplificateur mais susceptible de rendre les événements supportables : « les gestes du pinceau lui suffisaient à réduire la pesanteur, à se libérer de la douleur et à flotter », écrit le narrateur de Salagnon (p432). Pour y exceller vraiment, escompter d'y trouver un véritable soulagement, il y faut beaucoup d’indifférence : C’est pourquoi le peintre idéal serait la neige, qui « sait sans rien savoir suivre le fil à la perfection, elle souligne sans trahir l’élan de sa courbe, elle montre ce fil mieux qu’il ne peut se montrer lui-même. » (p 318). « Je suis jaloux de la neige », risque Salagnon : « Je suis incapable de faire en le voulant ce que la neige réalise par son indifférence ».
La dernière caractéristique de cette forme de roman, c’est sa dimension intellectuelle Dans le contexte des années trente, lesquelles furent précisément des années d’entre-deux-guerres, de grands romans idéologiques inventèrent ainsi une parole militante moderne traversée par de vrais combats politiques ; je pense aux romans de Malraux, d’Aragon ou de Louis Guilloux : « Le roman, note Gaétan Picon, devient le moyen que l’écrivain choisit pour exprimer sa vision des choses, sa vérité intérieure, les mythes qui l’exaltent : l’équivalent de la confession, de l’essai, du traité de morale, du poème » (3) C’est par là que le roman de Jenni révèle avec le plus de cruauté le vide de l’époque. Lui-même l’affirme : « les événements posent une question infinie à laquelle raconter ne répond pas » (p 51). Or quelle idée forte, quel engagement, quelle réflexion politique émergent de la profusion et de l’enchainement des tableaux ? « Rien dans la République ne peut justifier que vivent sur le même sol des citoyens et des sujets » (p 568). La perplexité nous gagne. Est-ce finalement pour aboutir à une si pauvre exégèse qu’un si long texte fut écrit ? Entre la complexité narrative et la simplicité du propos, quand le combat militant se résume à du politiquement correct, et la parole poétique à du lieu commun, un tel fossé se creuse entre la réalité évoquée et le simple vœu pieux prononcé…
Avec son parti-pris d'une narration sagement ordonnée, d'un propos normé, cet ouvrage à la fois intéressant mais si peu innovant révèle bien le mal dont souffre notre époque dans le consensus de la société du spectacle. Parce qu'il n'embrasse au fond qu'une réalité passée, le souffle idéologique ne peut que s'échouer dans le discours didactique des manuels d’histoire, et la fresque lyrique s’affadir dans le documentaire culturel du type d’Arte. Cela vaut bien un Goncourt, me direz-vous.
1 – Christopher Lasch – La Culture du narcissisme, Climats – 2000, p 31
2 et 3 – Gaétan Picon – Panorama de la nouvelle littérature française, Tel, Gall n° 138 –p 53
05:39 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : prix goncourt, alexis jenni, l'art français de la guerre, gallimard, littérature | 
mercredi, 02 novembre 2011
La gazette de Solko n°7
00:07 | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : solko, politique, g20, cannes |