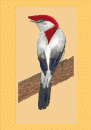mardi, 31 juillet 2007
Sale temps pour les tréteaux
Après avoir décliné avec véhémence sa nomination au Collège de France, Ariane Mnouchkine est revenue sur sa décision (Le Monde, 28 07 2007) et déclare ne pas vouloir faire de caprice auprès de gens qu'elle aime et admire" L'égérie de la gauche bobo-momifiée, on s'en souvient, n'en fit pas, non plus, pour lâcher les intermittents du spectacle en juillet 2004, lorsqu'un bras de fer opposait ces derniers avec le pouvoir politique de droite en Avignon. La fille à papa du théâtre du Soleil, aujourd'hui mémé gâteuse au quartier latin a-t-elle voulu nous faire croire qu'elle avait soudain retrouvé du courage politique ? Elle qui, à l'abri des milliards de son père Alexandre, vomissait jadis l'Institution sous couvert d'Odéon, ne crache plus longtemps dessus sous couvert de Collège de France !
C'est vrai que le bouddhisme aide à se détacher de tous les faux semblants de ce bas monde ! Finalement, l'ardente "metteuse en scène" de Cixous et le brûlant soutien de Ségolène devrait se réjouir de la victoire écrasante de Sarkozy : Au moins ne prendra-t-on pas sa nomination comme un renvoi d'ascenseur entre Précieuses Ridicules. Son seul souci étant qu'on ne la prenne pas, non plus, pour un ralliement à Sarko, dame Trissotine précise :"Je me sens instrumentalisée par la Présidence de la République, et je ne l'accepte pas"!!!!!
L'ego surdimensionné d'Ariane n'a vraiment d'égal que sa fatuité. Et son hypocrisie frôle ici celle des vieillards moliéresques, dont elle ne doit plus beaucoup être capable de rire. Comme il est loin le temps de la coopérative ouvrière et de la Cartoucherie de Vincennes, Ariane ! Et à quand, sur les traces de Marguerite, un fauteuil à l'Académie, auprès de Jean d'Ormesson ? Il paraît que plusieurs sont vacants. Pour moi, je me demande avec Molière ce qu'une femme aussi savante que toi pourra bien enseigner au Collège de France : La recette des nouilles asiatiques ou l'art d'enc... son public ? On attend la Leçon Inaugurale avec impatience pour en décider.
11:40 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, contemporain, société, politique, littérature, actualité | 
dimanche, 22 juillet 2007
LEON BLOY ET LA SALETTE
« D'autres voient Marie dans la gloire. Je la vois dans l'ignominie. J'ai beau faire, je ne me représente pas la Mère du Christ douloureux dans la douce lumière de Lourdes. Cela ne m'est pas donné. Je me sens peu d'attrait vers une Immaculée Conception couronnée de roses, blanche et bleue, dans les musiques suaves et dans les parfums. Je suis trop souillé, trop loin de l'innocence, trop voisin des boucs, trop besogneux de pardon »
Ainsi parle Léon Bloy, dans Celle qui pleure, l'un des deux importants ouvrages consacrés par lui à Notre Dame de la Salette. Toute sa vie, Bloy a été un dévot de cette Vierge-ci, Celle qui porte autour du cou le marteau et les tenailles rappelant aux hommes ce que, par eux, son fils a subi et qui, apparue à deux enfants-bergers qui ne parlaient que du patois, le 19 septembre 1846, a livré deux secrets dont un seul (celui de Mélanie) a été dévoilé. Toute sa vie, Bloy a défendu cette Mélanie-ci, précisément, l'enfant sauvage, l'enfant-louve qui ne jurait que par sa révélation, sa Dame de Feu,  et tint tête aux hommes et aux femmes, à tous les humains, des francs-maçons les plus roués aux plus hautes autorités de l'Eglise. Toute sa vie, Bloy l'a défendue jusqu'à comparer son dénuement et son discernement à ceux de la Marie du Magnificat. Cette dévotion est la clé de la poétique de Bloy. La chambre obscure où se forge le regard qu'il jette sur ses contemporains, la voix incomparable qui est la sienne parmi les mondains fades ou conventionnels de la Belle Epoque.
et tint tête aux hommes et aux femmes, à tous les humains, des francs-maçons les plus roués aux plus hautes autorités de l'Eglise. Toute sa vie, Bloy l'a défendue jusqu'à comparer son dénuement et son discernement à ceux de la Marie du Magnificat. Cette dévotion est la clé de la poétique de Bloy. La chambre obscure où se forge le regard qu'il jette sur ses contemporains, la voix incomparable qui est la sienne parmi les mondains fades ou conventionnels de la Belle Epoque.
Il faut lire Bloy.
Tout Bloy.
Je ne parle pas forcément en quantité, mais en qualité. Lire entièrement chaque phrase dans la totalité de son écriture, pour apprécier l'importance de cet auteur qui fut le seul à percevoir et à dire aussi effroyablement l'événement majeur de son temps : la déchristianisation de la France par le moyen diabolique de la déchristianisation de l'Eglise. Cheminant à travers le secret de Mélanie, la petite Bergère de la Salette, Bloy a composé son œuvre comme on avance sur un chemin de croix. La lucidité, l'effroi, le style, la ténèbre et la lumière qui la traversent de part et d'autre demeurent ses meilleurs avocats, à l'heure vide pour la littérature que nous connaissons.
Texte du secret de La Salette
écrit et daté par Mélanie à Castellamare, le 21 novembre 1878
Nihil obstat et Imprimatur Datum Lycii ex Curia Episcopi, die 15 nov. 1879.
Carmelus Archus Cosma. Vicarius Generalis.
22:25 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : livres, christianisme, littérature, bloy | 
vendredi, 06 juillet 2007
Henri BERAUD
Je quitte à l’instant l’œuvre de Béraud. Et il me semble qu’il ne l’a jamais écrite, à peu de gens près, que pour lui-même. Comme tous les écrivains. Je ne parle pas, bien sûr, des grands reportages ni des pamphlets polémiques. Comme Joseph Kessel, comme Albert Londres, auxquels il ouvrit bien des portes, il rédigea les premiers pour vivre. Quant aux seconds, dans le contexte rudement cauchemardesque de la seconde moitié des années trente, il estima que c’était son devoir d'être de la bagarre en les faisant publier.
Je parle d’une bonne quinzaine de livres, ce qui n’est pas absolument rien. Et je n’hésite pas à croire que si la littérature française doit sortir vivante de la vacuité sidérante et du conformisme accablant dans lesquels l’ont plongée aussi bien l’institution universitaire que les politiques éditoriales de ces quarante dernières années, la redécouverte de cette œuvre par de jeunes ou de nouveaux lecteurs aura un rôle déterminant à jouer.
Car il y a dans la phrase d’Henri Béraud quelque chose d’asséné et de brutal, de juste et d’élégant, et même souvent de raffiné, qui fait sa fête à tout amoureux de la langue française. Henri Béraud ne fut ni un idéologue, ni un penseur, ni un politique Contrairement à beaucoup d’hommes de sa génération, il sortit la vie sauve de l’enfer des tranchées de quatorze dix-huit. Comme beaucoup d’hommes de sa génération, il sut alors qu’il avait sacrifié son existence, car la société au sein de laquelle elle s’apprêtait à se dérouler avant que la boucherie ne commence, cette société, bel et bien, n’était plus. C’est pourquoi il jeta sur le monde un regard à la fois baroque et lyrique, l’un de ceux qui siéent mal au sérieux que lui demandait son temps : un regard de revenant désenchanté. Iceberg anachronique et têtu, n’explique-t-il pas encore, en 1944 ainsi sa conception politique : « Elle s’exprime toute dans l’amour de la France, la haine des Anglais et le refus de toute obédience étrangère » Cette politique qui, dit-il « a suffi à nos vieux rois, aux hommes de 93, à Napoléon, peut bien suffire à un fils de boulanger.»
L’effacement d’un grand auteur, quel qu’il soit, est toujours significatif de quelque chose. Dans une démocratie sur-médiatisée de pied en cap, le fait d’honorer chaque 11 novembre la mémoire d’un soldat inconnu est évidemment moins compromettant que le fait de perpétuer la mémoire d’un soldat qui fut trop connu et, surtout, inconsidérément bavard. Pour sa défense, c’était son métier de parler ainsi. Loin de moi l’idée d’attenter à la justesse d’une commémoration dont Béraud lui-même écrivit un jour que les Allemands nous en enviait l’idée. Le fait est que, pour son malheur, Henri Béraud a appartenu à cette génération-là - que des cadets opportunistes auront singulièrement réduite au silence- et qui, parce que la gloriole la faisait rire, a laissé faire. Brasillach eut les honneurs d’un procès en bonne et due forme. Celui de Béraud, qui passa avant, lui, est une atroce caricature.
09:40 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, béraud, lyon, houdaer | 
mardi, 03 juillet 2007
l'escargot
Une lecture humide de ce temps y déplorera évidemment en tous lieux ce règne sans partage du sec. La violence est sèche. L’à peu près est sec. La combinaison de la violence et de l’à peu près, dont le fait politique comme le fait divers répercutent jusqu’à nous la nauséeuse contingence, favorise un environnement qui est peu propice au suave et lent étirement de l’algue sur la plage, tel que l’humide le sollicite : quelle vulnérabilité, à ce point, pourtant me rappelle la lumineuse trace, sur l’arceau, de l’escargot sous la tonnelle ? A celui qui le regarde, le sobre architecte de son simple passage n’intime aucune persuasion : cherche-t-il même à communiquer quoi que ce soit ? Telle est l’insolence de l’exploit poétique, que de sa vitalité éphémère, il ne tire qu’une compétente discrétion.
09:45 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poème, poésie, littérature, littératures | 
jeudi, 28 juin 2007
Le Moine (d'après M.G.Lewis)
Préface de MONK LEWIS, libre adaptation théâtrale du roman de Lewis, Le Moine, rédigée à l’occasion de la reprise de la pièce par la Cie Le Paragraphe, juillet 1998, théâtre La luna, Avignon. Ci-dessous, portrait de Lewis par Henry William Pickersgill
 1795 : Lewis n’a que vingt ans lorsqu'il conçoit son Moine. Un âge, dira-t-il, “ dont on ne peut attendre la prudence ”. En contant la chute frénétique du prieur le plus vertueux de Madrid précipité par le diable dans les cavernes et les montagnes en un rocambolesque dénouement, le jeune attaché d’ambassade s’impose immédiatement comme l’un des maîtres du roman gothique. Ce roman, qui commença par faire frissonner toute l’Angleterre, puis toute l’Europe romantique, demeura pourtant sa seule production d’importance, au point que le jeune auteur traversa le dix-neuvième siècle sous le nom de MONK LEWIS.
1795 : Lewis n’a que vingt ans lorsqu'il conçoit son Moine. Un âge, dira-t-il, “ dont on ne peut attendre la prudence ”. En contant la chute frénétique du prieur le plus vertueux de Madrid précipité par le diable dans les cavernes et les montagnes en un rocambolesque dénouement, le jeune attaché d’ambassade s’impose immédiatement comme l’un des maîtres du roman gothique. Ce roman, qui commença par faire frissonner toute l’Angleterre, puis toute l’Europe romantique, demeura pourtant sa seule production d’importance, au point que le jeune auteur traversa le dix-neuvième siècle sous le nom de MONK LEWIS.
1931 : L’histoire d’Ambrosio est à nouveau racontée, par Antonin Artaud qui déclare effectuer “ une copie en français du texte original ” Sa publication chez Denoël suscite un engouement nouveau chez un nouveau public. Breton salue “ le souffle du merveilleux qui l’anime tout entier ” Amours fantastiques, couvents en flamme, revenants errants, le surnaturel explose de toute part tandis que s'enchevêtre en arrière plan un réseau complexe d'intrigues familiales : A l’origine, en effet, se trouve le malheur d’un couple : Elvire, la fille d’un cordonnier de Cordoue, et le marquis Las Cisternas. Le Moine, à bien y regarder, c’est l’histoire d’une famille décimée par un ordre social intolérant, une religion d’apparat, une société à l’aube de sa décadence. Lui-même enfant de divorcés, Lewis reprochait à ses parents de l’avoir placé dans une situation difficile. C’est dans une situation bien plus périlleuse encore qu’il place ses personnages. Ambrosio, enlevé encore bébé à sa famille ; Antonia élevée dans l’ombre austère des châteaux de Murcie... Derrière les paravents de l’artificielle lutte entre le Bien et le Mal, la difficile constitution du couple, qu’il soit incestueux ou légitime, est un facteur omniprésent au cœur de l'action, à la fois parce qu'elle en est le ressort constant et la problématique essentielle. “ L’expérience m’a appris à mes dépens que le malheur accompagne les alliances inégales ”, déclare Elvire lorsqu’elle refuse la main d’Antonia à Lorenzo. Aussi n’est-il n'est pas innocent qu'à vingt ans, aussitôt achevé son roman, le jeune Lewis se soit empressé d'écrire une lettre à sa mère :
Qu’une courtisane mandatée par le diable cherche à séduire un moine dont la chasteté est légendaire fournit l’occasion d’en exposer une première variante. Que désire Ambrosio, sinon jouir de la femme sans engager son cœur ? Et que désire Mathilde, sinon utiliser son pouvoir de séduction pour égaler - sinon dominer - le sexe masculin. On comprend que dans de telles conditions l'Amour soit exclu de la partie, c'est ce que stigmatise la présence plutôt comique du diable entre les deux personnages. Figure de la jouissance et de la manipulation, tous deux plus complices qu'amants, ce couple n'en est un qu'en apparence. C'est pourquoi il lui faut toujours se nourrir d'un tiers et vivre dans la clandestinité. C'est pourquoi, également, la satisfaction entre eux est toujours un leurre, quelque chose qui est inévitablement remis à plus tard, qu'il convient d'invoquer incessamment, de mettre en scène et de magnifier en ayant si possible recours aux ustensiles les plus énigmatiques (miroirs et myrtes magiques sont la version gothique des accessoires sado masos d'aujourd'hui)
Agnès et Raymond représentent un pôle opposé. Ils devront apprendre à "vivre paisiblement", c'est à dire à vivre ensemble, sans se passionner pour autre chose que pour leur couple. Au prix d'un certain nombre de souffrances, tous deux devront par conséquent renoncer à leur univers de célibataires ou bien d'enfants, univers qu'avait fortement déterminé une autorité parentale dévoyée : Agnès a été placée au couvent contre son gré, par une tante fanatique. Le père de Raymond s'étant opposé à l'amour de son fils aîné pour une roturière, lui, le fils cadet en subit les plus immédiates conséquences, selon la loi de ce qu’Hoffmann, à la même époque, appelle “ l’enchaînement des choses ”. L'enfant perdu d'Agnès est une réplique logique de l'enfant perdu d'Elvire : La réussite finale de leur couple ne sera possible que lorsque chacun se sera échappé de la malédiction - forme religieuse de l'aliénation - parentale. Raymond devra donc rendre la part de l'héritage qu'avait refusé d'octroyer son propre père, et Agnès enfreindre des vœux qui n'étaient au fond que ceux de sa tante. Leur union est révélatrice d'un passage agité de l'adolescence à l’âge adulte, d'un état de nonne ou de celui d'aventurier à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un honnête mariage bourgeois. Mais elle est surtout l'aboutissement d'un passage initiatique : les deux héros auront dû se libérer de la "tribu bavarde", ils auront cessé d'en recevoir les "fientes" - autrement dit les névroses - sur le visage. Pour enfin être heureux ? On ne saura rien de leur bonheur futur, tout laissant à penser que Lewis ne croît guère au conte de fées.
Frère et sœur qui s'ignorent, Antonia et Ambrosio incarnent le couple paroxystique par excellence, puisque incestueux. Du point de vue dramatique, - même s'il se trompe sur ses motivations puisqu'il ignore les faits passés - il est juste qu'Ambrosio se déchaîne contre Agnès : en l'enlevant à Raymond, il ne fait que rendre à la famille de ce dernier, qui lui a volé ses parents, la monnaie de sa pièce. Mais est-il juste qu'il s'acharne sur Antonia ? Ces deux-là paient en réalité les pots cassés sans avoir les moyens de le comprendre. Lorsque la sœur dit au frère : “ La perte d’une mère étant, de toute peine, la plus irrémédiable en une vie humaine ”, le moine s’entend dire la plus secrète parole de vérité le concernant. Dans la pièce, comme dans le monde, les enfants subissent en effet l'inconscience de leurs parents. Le Moine est, comme beaucoup, un roman où l'on règle des comptes de famille. On en revient à la figure de la mère, pour constater plusieurs choses : premièrement, qu'à ses côtés, le père est absent ; seule figure qui en représente de loin l'autorité, le cardinal duc grâce auquel à la fin tout rentre dans l'ordre. Sorte de Deus ex machina, l'action paternelle est nulle sur le plan affectif, et seulement opérante sur le plan dramatique. Deuxièmement, que la mère est sommée de payer pour sa faute originelle : Elvire a transgressé une règle sociale (et donc masculine) en épousant un marquis. Ce dernier n'a pas su se libérer de l'influence négative de son propre père, ce qui explique qu'il soit mort et sa descendance en aussi mauvais point. Léonella, la sœur d'Elvire, laisse entendre que cette dernière a agi peut-être par amour, sans doute par ambition mais surtout par coquetterie. Ce couple originel, dont on ne sait que fort peu de choses, sinon qu'à cause de lui, un cordonnier honnête fut jeté en prison, et que le héros éponyme vit le jour, n'a visiblement pas su assumer les conséquences inévitables de ses actes et est à l'origine des dérèglements de chacun. Le Moine apparaît donc comme un drame de la responsabilité. Qu' Elvire soit étranglée par la soutane de son fils, et que ce dernier l'étrangle en étant complètement nu ; que par ailleurs le jeune Lewis se presse, sitôt écrit, d'envoyer son manuscrit à sa mère, il y a sans doute là les traces d'un discours personnel assez opaque mais ô combien révélateur ! Que l'on juge le déterminisme absolu qui régit la composition de l'intrigue désuet, agaçant, excessif, comique, voire ridicule, il convient de le saluer car c'est lui qui est à l'origine de la force fantastique du roman, applaudie dès sa publication.
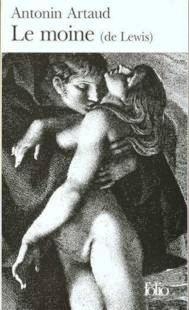 Ainsi que l'explique l'ironique Coryphée de l'adaptation qui suit au jeune Théodore, les personnages du roman sont donc des trajectoires creuses mais, toutes, prédestinées, jetées en pâture à la Merveille pour la plus grande joie du lecteur. Il m'a semblé que, parmi ceux de Lewis, un personnage incarne particulièrement ce point de vue. Le jeune Théodore est, au problème de l'amour impossible posé par la pièce, une sorte de réponse. Lui-même, spectateur témoin du fait de sa position de valet, constatant qu'il n'était pas encore émancipé du terrible jeu de destruction qui l'environne et conscient de l'impossibilité dans laquelle chacun se trouve de fonder un bonheur légitime et durable, il a, dit-il "renoncé à ses amours”. C'est donc à son maître qu'il a promis fidélité. Cette option n'est sans doute pas définitive. C'est, comme Lewis, un jeune homme ; c'est aussi un romancier en herbe qui se plaint de n’avoir pas de temps à consacrer à l’écriture. Contemporain des personnages, seul personnage en réel apprentissage, il aurait pu écrire le roman s'il en avait eu la clé, c'est à dire, comme lui suggère le Coryphée, s'il avait été libre. Ce coryphée est, chez Lewis, une simple bohémienne. Artaud lui fait chanter sa “ ballade du vrai charlatan ” et la transforme en une mystérieuse voyante surréaliste. Dans la pièce qu’on va lire, il est le chef des mendiants de Madrid, celui qui voit les choses telle qu’elles sont, dans l’histoire, et telles qu’elles seront un jour, dans le récit et dans ses prolongements possibles.
Ainsi que l'explique l'ironique Coryphée de l'adaptation qui suit au jeune Théodore, les personnages du roman sont donc des trajectoires creuses mais, toutes, prédestinées, jetées en pâture à la Merveille pour la plus grande joie du lecteur. Il m'a semblé que, parmi ceux de Lewis, un personnage incarne particulièrement ce point de vue. Le jeune Théodore est, au problème de l'amour impossible posé par la pièce, une sorte de réponse. Lui-même, spectateur témoin du fait de sa position de valet, constatant qu'il n'était pas encore émancipé du terrible jeu de destruction qui l'environne et conscient de l'impossibilité dans laquelle chacun se trouve de fonder un bonheur légitime et durable, il a, dit-il "renoncé à ses amours”. C'est donc à son maître qu'il a promis fidélité. Cette option n'est sans doute pas définitive. C'est, comme Lewis, un jeune homme ; c'est aussi un romancier en herbe qui se plaint de n’avoir pas de temps à consacrer à l’écriture. Contemporain des personnages, seul personnage en réel apprentissage, il aurait pu écrire le roman s'il en avait eu la clé, c'est à dire, comme lui suggère le Coryphée, s'il avait été libre. Ce coryphée est, chez Lewis, une simple bohémienne. Artaud lui fait chanter sa “ ballade du vrai charlatan ” et la transforme en une mystérieuse voyante surréaliste. Dans la pièce qu’on va lire, il est le chef des mendiants de Madrid, celui qui voit les choses telle qu’elles sont, dans l’histoire, et telles qu’elles seront un jour, dans le récit et dans ses prolongements possibles.
Reste Lucifer. Doit-on le prendre au sérieux ? La pensée devient-elle confuse et sort-elle de ses gonds, les personnages se laissent-ils dérober la maîtrise de leur corps ou bien celle de leur esprit, il se manifeste facétieusement. Que faire de lui dans l'adaptation théâtrale ? La religion, sur Terre, n’étant plus qu’une mode, lui-même se retrouve au chômage dans un enfer pitoyable où tout le monde s’ennuie. Riante figure de l'Illusion, il délivre donc une formidable occasion de jouer avec des mots. Un personnage sent-il son emprise, il se met à rimer malgré lui. Il se définit comme le metteur en scène absolu, sans pour autant lui-même être dupe. Les hommes, déclare-t-il, se chargent eux-mêmes de leur propre damnation, entendons de leur propre malheur. En réalité, Lucifer est l'agent ludique de l'inconscience de chacun, car c'est bien cette dernière comme on l'a dit, et principalement celle des parents, qui fonde le moteur de l'action. En veillant à ce que le destin réel d’Ambrosio s’accomplisse (réintégrer, même de façon tragique, son histoire familiale), et non pas son destin imaginaire (devenir prieur charismatique de Madrid), il est une forme incarnée de l’exactitude et de l’enchaînement logique des événements. C’est ce qu’a compris Mathilde (“ Entre ses mains, je confie mon salut ”), ce que pressent Ambrosio (“ En enfer, ce n’est peut-être que moi que j’attends ”). Elvire elle-même n'est-elle pas la toute première à l'affirmer à son ingénue de fille : N'aie pas peur du diable !
Drame de la responsabilité, de la liberté et de l'aliénation, le Moine, par les problèmes qu'il pose ( prédestination familiale, absence des pères, échec des mères, guerre des sexes, quêtes illusoires, conflits de classes ) reste, malgré son décorum gothique, d'une singulière actualité et d’une lecture très ouverte : Ses personnages, avec leur immense volonté de jouir de la vie, demeurent toujours accessibles et, s'ils s'inscrivent dans une période historique rigoureusement définie par Lewis (l'Espagne du Siècle d'Or), ils n'en sont que plus modernes pour nous, si profondément enfouis dans la nôtre. Les querelles religieuses ont cédé le pas aux querelles idéologiques qui, à leur tour, cèdent le pas à d'autres, sociales ou économiques. Mais les conflits de ces personnages aux prises avec leur psyché, eux, sont plus que jamais d'actualité. L'immense cri d'amour qui surgit de leurs dérèglements et que répercutent les symboles qui sont les leurs ne peuvent aujourd'hui qu'émerveiller un public en mal de véritables sensations artistiques. Voilà pourquoi, sur les traces du jeune ambassadeur Lewis, j'ai voulu traverser les frontières obscures et illuminées de leurs songes en composant cette libre adaptation.
20:45 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monk lewis, roland thevenet, le moine, théâtre, mathew gregory lewis, littérature | 
mercredi, 21 mars 2007
Les épuisés
Si le patrimoine littéraire de la ville vous intrigue, une seule solution : les bouquinistes ! Le chef-d’œuvre de l’été ( non, pas celui qui réalisera les meilleurs tirages, celui qui vous fera le plus grand plaisir ! ) vous attend peut-être dans leurs rayons : à vous de fouiner patiemment…
Parmi la multitude de joyaux pur-lyonnais à redécouvrir, Le roman d’un vieux Groléen de Georges Champeaux (1919) pour les habitants de Vaise et Périssoud, militant lyonnais de Charles Joannin (1932) pour ceux de la Guillotière. Pour se balader en silence au sein de ces deux anciens faubourgs-ouvriers emplis de figures réalistes et d’anecdotes savoureuses, rien de mieux.
Les amoureux d’Ainay et des quais de Saône, de Saint-Georges à l’Homme de la Roche , satisferont leur nostalgie avec Sous le signe du Lion de Tancrède de Visan (1935), un étrange Huysmans local qui ne se laisse bien goûter qu’au troisième degré. La trilogie de Joseph Jolinon (Dame de Lyon, L’Arbre sec, Le Bât d’Argent (1931-1933), qui campe les malheurs privés d’une famille bourgeoise d’entre deux guerres, déroule aussi les ambiances de ces quartiers, avec des excursions coquines de l’autre côté du pont de la Guille. De même, l’autobiographie de Gabriel Chevallier (Chemins de solitude-1946, Carrefour des hasards -1956), sensible et bien documentée, qui reste par ailleurs le must incontournable pour qui s’intéresse au passé artistique et intellectuel de la ville. Si Chevallier est introuvable, vous pouvez toujours vous rabattre sur Marcel Grancher (Lyon de mon cœur, 1932, Reflets sur le Rhône, 1941) ou Léon Riotor (Léon de Lyon, 1934). C’est moins solide, mais on y apprend des choses.
Beaucoup de romans ont été composés sur la fabrique lyonnaise et sur le quartier du Griffon. Les deux meilleurs demeurent Mademoiselle Dax, jeune fille de Claude Farrère (1908) et Ciel de Suie d’Henri Béraud (1933). Les amateurs d’intrigues sentimentales peuvent enfin se plonger dans le charme désuet du Chemin des Deux-Amants et de La Montée des Anges de Max André Dazergues (1938-1940) : si vous aimez le kitsch et l’eau très rose, vous en aurez pour votre argent.
Les spécialistes de tous ces épuisés vous attendent à La librairie des Terreaux, rue d’Algérie, à l’Epigraphe, place des Tapis, chez Diogène, rue Saint-Jean. N’oubliez jamais de flâner régulièrement les samedi et dimanche après-midis le long du quai de la Pêcherie. Ouvrez les pages jaunies, épaissies, odorantes. Puis prenez le temps de choisir. Tous ces titres (parmi de nombreux autres) sont vendus entre 5 et 15 euros, selon l’exemplaire et l’état de conservation.
Pour les plus pressés, je signale la réédition, par les Traboules, de deux fresques romanesques captivantes : Les Gueux de Lyon de Pierre Vires, ainsi que le très classique Myrelingues la Brumeuse de Claude le Marguet ( un Dumas magnifique et passionné du Lyon de Rabelais, de Scève et de Louise Labé). Cette sélection, loin d’être exhaustive, ne serait pas juste sans un rappel : Clair Tisseur (alias Nizier du Puitspelu) n’est pas seulement l’auteur du Littré de la Grand ’Côte. On trouve encore quelques exemplaires des Vieilleries Lyonnaises et des Oisivetés du Sieur Puitspelu . Mais ils sont plus onéreux !
A quand, une réédition pour toutes les bourses ?
Bon été à tous.
Article paru dans L'Espit Canut (juillet 2006)
08:20 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, littérature |