mardi, 14 octobre 2014
Lettres et durée
Celui qui dessinait des lettres destinées à être fondues, c'est-à-dire à s’inscrire dans une durée préméditée, leur imprimait une trace de lui-même et de son temps Mais à l’heure actuelle, « il est très difficile de gagner sa vie en dessinant et en commercialisant ses propres caractères, même s’ils ont du succès », constate Lewis Blackwell dans son livre Typo du 20° siècle.
Ainsi, ce qui fut vrai de Manuce et de Garamond, de Didot et de Morison, d’Eric Gill et même encore de Cassandre ou d’Excoffon, ne l’est plus aujourd’hui d’un dessinateur, fût-il le plus doué. Car lorsqu’un métier « ne paye plus », plus rien ne sort de lui. C’est un fait qui se vérifie un peu partout de nos jours, dans la typographie, certes, mais également dans tant de techniques et d’arts où la standardisation va de pair avec la démocratisation, la médiocrité avec la massification, le talent de tous avec celui de personne.
Quand je pense au mal que nous avons pris de naître, et à celui que nos parents ont eus à nous élever, et tout ça pour assister à ce naufrage lent, du politique, de l’esthétique, de l’éthique, à ce dépérissement de la qualité et de la vigueur, au profit de la quantité et de la malfaçon. Quand je vois la médiocrité galopante des individus qui siègent au sommet de l’Etat, celle de ceux qui, un peu partout, prostituent le beau nom d’artiste, quand je vois le culte rendu à des sportifs et à des comédiens pelliculés, je me réjouis de sentir que la plus grande part de moi échappe encore à leur société et à leur monde, malgré tout le temps que j’ai passé dedans pour gagner ma vie.
Je me réjouis d’être ému (parfois jusqu’aux larmes) par une statue du Juste, tout noir de suie, tenant l’Enfant dans ses bras dans la pénombre d’une chapelle, ou silencieux durant des heures à me répéter la beauté d’un poème appris autrefois dans un lycée de pierres, ou, mieux encore, d’une prière tenue jadis de l'Eglise et redite mot à mot, syllabe par syllabe et presque lettre par lettre, comme si je les dessinais dans ma seule pensée en articulant leurs lettres de caractère, dans le silence et la solitude de l’instant unique, et qui file.
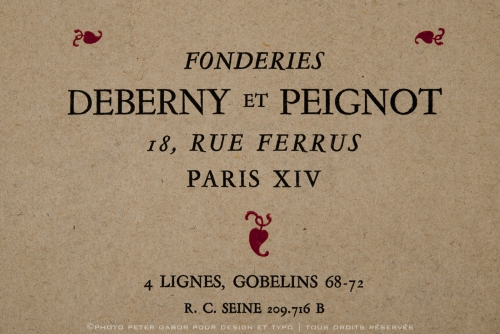
Catalogue des fonderies Deberny et Peignot,
23:09 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française, Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : peignot, morison, manuce, garamond, gill, didot, cassandre, excoffon, typographie, blackwell | 
mardi, 03 juin 2014
Vichy était petit
à Philippe Nauher, avec une amicale complicité
Vichy s’est imperceptiblement envasé dans les entrailles des époques ordinaires. Là, elle ne palpite encore qu’à peine, avec ses demi-pressions à 4Є 30 rue Lucas, fantomatique épave, échouée à moitié vive en ce siècle que la consommation livre à l’amnésie. Quelques solitaires s’y égarent. Sous la promenade couverte du parc des Sources, leurs pas seuls animent la galerie jadis festive et jadis impériale, qui peut le croire encore ? Car à longer ces colonnes de fer moroses par ces temps uniformisés, on perçoit confusément que le destin de Vichy ne peut que rejoindre l’essence même de l’ordinaire, jusqu’à s’y morfondre, s’y confondre, pour toujours, dirait-on. Ici-même, oui, bien plus qu’en n’importe quelle autre ville de France.
Les vitrines de Vichy jettent au visage des passants attentionnés qui les longent tout ce que la province des années soixante-dix et quatre-vingts exhibait de plus parisien, alors elle s’exprimait encore en Excoffon pour crier son tout dernier chic tout en en swinguant. Ses passages couverts, illustres du temps de Napoléon III, ne sont plus que le prétexte d’une flânerie lunaire, qu’enrichit infiniment leur désolation. La plupart des commerces sont déserts. Les uns ont fermé - rideaux de fer, moellons – et, sur les avenues, recyclés en restaurants du monde (indiens, marocains, italiens), d’autres accueillent les touristes venus participer à des tournois de scrabble ou des congrès de voyance & divination. Des banques. Beaucoup d’agences immobilières.
Le promeneur attentif, au vu de leur grand nombre, pourrait s’imaginer que la ville est désormais à vendre. Villas, appartements, longères, demeures, tout passe, tout fait son temps, même ce charme aussi désuet que confortable d’une vie bourgeoise à l’érudition provinciale, à l’ennui assumé, que les notables de l’élite mondialisée, en le délaissant, ont livré à la braderie technologique des sans humeurs. A VENDRE donc à qui veut, à qui peut, et pour pas cher le m2, renchérirait le bateleur sûr de son coup, au vu des tarifs qui se pratiquent partout ailleurs, même dans les pires banlieues des violentes métropoles multiculturelles, connectées et polluées. Pour pas cher, respire donc cet air et cette allure, ce parfum d’antan – te dis-tu, en marchant dans l’autrefois des fenêtres closes– l’œil levé en direction de leurs garde-corps, si élégamment ouvragés. Forger le fer au plus raffiné du détail, le détail au plus proche du besoin. Ah, ces fières demeures en pierres, l’esthétique encore fidèles aux règles d’or de Soufflot, malgré les fioritures qui leur pèsent.
Songes-tu un instant à l’intrusion soudaine des temps extraordinaires qui marquèrent pour quelques années cet espace autour de nous, d’un fer autrement rouge et brûlant ? Oui je songe : Quel tour prit donc ce Vichy des années de fièvre et de douleur, lesquelles étendirent leur trace de sang et de suie jusqu’aux confins les plus hivernaux de l’Europe ? Ceux qui peuplèrent ces palaces art Nouveau transformés en garnisons et ministères, ceux dont les semelles battirent les parquets et les pavés, qu’ils fussent soldats ou fonctionnaires, du Reich allemand ou de l’Etat français : qu’en demeure-t-il ? Ceux qui s’assirent en grappes exaltées pour s’emplir l’esprit des colonnes de leurs journaux, aux terrasses de ces brasseries, du militaire au journaliste, du parlementaire au soldat, de l’ambassadeur au badaud, de l’anonyme quidam vichyssois soudainement égaré sur son sol natal parmi une foule d’inconnus, enfin, jusqu’au collabo cynique et fraichement débarqué de Paris ? Oui, je songe.
« Vichy était petit », écrivit Emmanuel Bove en 1945 (1) La ville l’est encore, à l'heure du monde ouvert. On y tourne donc en rond, toujours aussi hypnotiquement. Elle n’abrite plus les mêmes luttes, les mêmes terreurs ni les mêmes plaisirs, les mêmes espoirs ni les mêmes enjeux, rien n’y semble pour autant résolu. La crise économique s’y dévoile, comme naguère la collaboration. L’une se vautre, partout tristement perceptible ; le spectre de l’autre y plane, confusément déchiffrable dans le calme douteux qui flotte dans les rues, le murmure des disparus qui les imprègnent.
(1) (1) Emmanuel Bove, Le Piège, Flammarion

Vichy, parc des Sources
23:06 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : vichy, parc des sources, nauher, littérature, immobilier, collaboration, france, histoire, excoffon, napoléoniii, communication | 









