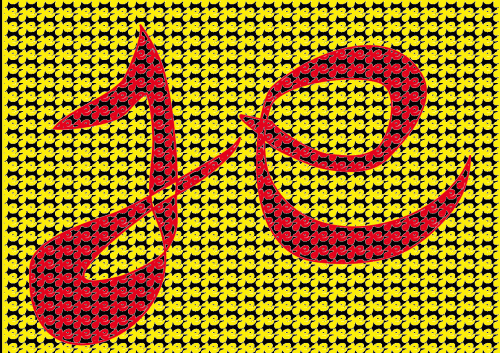lundi, 19 décembre 2011
Vanité du Je
Dans le silence de sa solitude, l’écrivain soucieux de style cherche à ne pas inscrire les mots du monde, les premiers à surgir, tout de suite, à s’imposer. Difficile, car tous ceux qu’il entendit depuis sa naissance lui sont venus de là, du monde. A commencer par celui par lequel sans cesse il s’énonça, et par lequel il se présente encore en levant d’un ongle la visière de sa casquette : celui que tout le monde mâche en bouche pour parler de soi, ce risible, importun, défigurant car si peu figuratif je. Lieu commun, par excellence, territoire de tous. Le je du simple dire.
Avoir depuis toujours qualifié de ce pronom qu’on affirme personnel et qui est si vain son visage, sa pensée, son récit, sa propre sensation, tel est le propre de chacun. L’avoir, ce mot, si souvent accolé à tant d’éléments disparates qui l’ont traversé, d’émois temporels, oui, ce je fugace qui se proclame permanent : l’écrivain n’a donc fort cruellement que ça pour dire tout ce qui s’est passé ; car même s’il préfère en son for intérieur le silence des chats, le relief des couleurs, la résonance des sons, quel autre choix la parole lui laisse-t-elle que de se qualifier au moyen de ce je ?
Pour aussitôt s’en défaire. Car la parole est un tel édifice qu’il faut abandonner cette première clé pour se frotter au il, au on, au nous ou bien encore comme Kafka le fit à la virtuosité d’une simple initiale. Il lui faut, l’écrivain, laisser ce je au monde comme une sale vitre et pourtant, lorsqu’il ferme ainsi son carreau, les profanes croient déjà qu’il impose un masque et le malentendu se tisse. Tout, dans le langage, est vanité.
Le premier des mots du monde étant celui par lequel ce même monde m’apprit à me désigner face aux semblables, alors oui, on comprend de quelle vanité est faite la pate du langage; et que tout l’arbitraire du signe ne soit que déception à l’écoute attentive, et laisse démuni le visage incliné face à la page blanche. Douces, brutales, lancinantes, mornes, fiévreuses, exaltées, douloureuses sont les absences qui me traversent, et m’ont fait masque, que le murmure des mots, malgré cette malédiction, tente d’à nouveau façonner. Je…
Mon corps a une odeur, ma main a une empreinte, ma voix possède un timbre et mon pas son véritable rythme ; parler n’a que ce je à m’offrir, qui comme ce tu n’est qu’une mécanique sourde et sans relief, entonnoir par lequel se recentre sur l’exaspérant lyrisme d’un constant désaccord l’esprit des sept milliards que nous sommes.
Ecrire.
Quand, tel l’habit ôté pour que la peau frémisse, choit ce premier je trop lisse et trop douillet, et qu’un autre s’impose (toujours à son désordre reconnu), la vanité du simplement dire cesse-t-elle enfin pour que débute la témérité de l’art ?
20:50 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : littérature, vanité, l'exil des mots, kafka, dire je | 
mardi, 06 avril 2010
Géographiques (Bertrand Redonnet)
Je ne connais pas la Bouleure. Pourtant, si j’en crois le Géographiques que Bertrand Redonnet vient de nous offrir, et dans lequel j’apprends que ce « ruisseau versatile » fut pour lui « une appropriation poétique du monde », alors je dois avouer que si, si, bien sûr, je la connais. Même si la mienne porta un autre nom - la vôtre aussi, sans doute – je la connais fort bien : qui n’a pas au fond de soi une rivière où il connut le monde, enfant ? Nous avons tous nos paysages, tout comme nous avons chacun une langue, et c’est à ces paysages que chacun porte en soi que s’adressent ceux de Géographiques, les seuls, les vrais personnages de ce livre dont le premier tour de force est quand même d’effacer les humains de son tissu, jusqu'à nous les faire oublier presque totalement.
Des hommes, me direz-vous, il y en a bien quelques-uns dans ce livre, et qui causent. Une poignée de géographes, dont l’un ressemble à Ferré, l’autre à Roger Vailland, tous réunis autour d'une table en bordure de la Vistule pour évoquer cette mise à sac du climat par les hommes, cet acculement du paysage à son point extrême, cette «gigantesque erreur».  Drôle de géographes, tout de même, tout comme cet autre qui ressemble à Redonnet, chacun devisant de son coin de pays, qui sa Normandie, sa Bretagne, son Auvergne, ou sa Charente-Maritime. Certes. Avec ce sous-titre générique au pluriel, « divagations », Géographiques feint de se proposer à nous tel un récit polyphonique. Pourtant l’absence de guillemets ne doit-elle pas s’entendre comme un signe ? La lecture climatique que Redonnet fait du monde n’est que la face cachée de la lecture autobiographique qu’il nous tend de lui-même, puisque l’exil est, comme il l’a dit lui-même par ailleurs, une « notion du dedans ». Lecture métonymique d'un parcours, de son enfance charentaise à un exil polonais dont ce texte ô combien intime décline les raisons d’être, une par une.
Drôle de géographes, tout de même, tout comme cet autre qui ressemble à Redonnet, chacun devisant de son coin de pays, qui sa Normandie, sa Bretagne, son Auvergne, ou sa Charente-Maritime. Certes. Avec ce sous-titre générique au pluriel, « divagations », Géographiques feint de se proposer à nous tel un récit polyphonique. Pourtant l’absence de guillemets ne doit-elle pas s’entendre comme un signe ? La lecture climatique que Redonnet fait du monde n’est que la face cachée de la lecture autobiographique qu’il nous tend de lui-même, puisque l’exil est, comme il l’a dit lui-même par ailleurs, une « notion du dedans ». Lecture métonymique d'un parcours, de son enfance charentaise à un exil polonais dont ce texte ô combien intime décline les raisons d’être, une par une.
« L’exil des mots », d’abord (c’est le titre de son blog auquel ce lien renvoie), titre qu’il insère malicieusement dans son texte tout comme, à un autre endroit, le nom de son éditeur, « Le temps qu’il fait ». L’exil des mots quand, « ils ne sont plus, constitutifs ».
L'exil loin du climat natal, ensuite : « Enfant, nous dit le narrateur, quelque chose de non identifié ne collait pas entre le climat océanique et moi.» Quelque chose ne collait déjà plus, non plus, entre « l’espèce humaine et son habitat ». Cela n’a fait qu’empirer depuis ; chaque lecteur, même le plus inattentif aux paysages, a pu le constater : aussi le narrateur se refuse d’être, comme tant d’autres de ses confrères, l'un de ces «valets du corps social ». Comme le rêveur, il «ignore la moyenne » et comme l’auteur lui-même, il a donc entrepris de marcher « vers la démesure », en provoquant cet exil, dont le troisième de couverture nous dit qu’il est « volontaire ».
Le paysage, cependant, c’est ce qu’un poète ne peut fuir, où qu’il dirige ses regards et ses pas. Pas plus que la littérature C’est donc en géographe « cueilleur » ou « berger » (j’aime la connotation préhistorique de ces termes), en géographe d’un temps qui remonte à bien avant la découverte de l’écriture que Bertrand nous parle. Lui qui se veut un « mécréant du paganisme », il lui faudra me pardonner si je lui dis que c’est au catholique Bernanos que j’ai songé en le lisant, Bernanos qui, dans La France contre les robots, petit essai magnifique écrit en 1945, s’écrie : « rien n’est plus difficile que de prendre conscience d’un pays, de son ciel et de ses horizons, il y faut beaucoup de littérature. Les vieux paysages nous parlent à travers l’histoire ! » (1) On ne s’étonnera donc pas de voir ce narrateur, à quelques pages de la fin, nous souffler son propre nom à l’oreille dans un rire de corbeau, tout en reconnaissant dans le geste de trouer la glace polonaise une vieille ruse de son compatriote, le bien nommé Renart.
Je voudrais pour conclure revenir à la Bouleure. Car il me semble qu'au fond, le cours versatile de ce ruisseau peut figurer une clé de lecture de ce récit divaguant, dans lequel un poète paye une part de la dette que nous avons tous contractée envers la beauté du monde et celle de ses paysages. Car c'est à eux qu'en définitive, et la conclusion du livre le dit magnifiquement, appartient ce que nous avons de plus cher : notre mélancolie.
Bertrand Redonnet
Géographiques
Divagations
96 p., 14/19.
Mars 2010. ISBN 978.2.86853.532.0 — 15,00 Euros
(1) Georges Bernanos, La France contre les robots, chapitre V - 1945
________________________________________________________________________________________________
Autres textes de Bertrand Redonnet commentés sur ce blog :
Polska B - Zozo, chômeur éperdu
07:01 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : geographiques, littérature, le temps qu'il fait, bertrand redonnet, l'exil des mots |