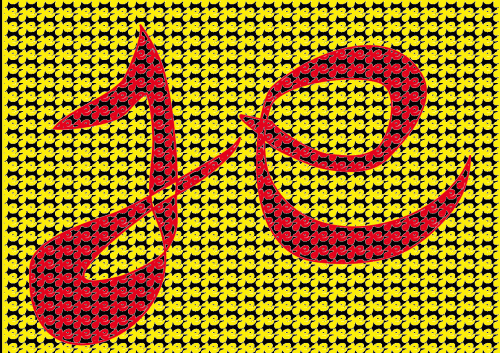mercredi, 03 juillet 2013
Aux plages, citoyens !
Eté: 5.000 policiers et gendarmes déployés pour la sécurité des vacanciers
On prend presque peur en lisant le titre de 20 Minutes : Al Qayda aurait-il envoyé des hordes de terroristes islamistes ? Le vilain Bachar, las d’entendre les rodomontades fabiusiennes, aurait-il lâché ses armes chimiques sur les plages de la Douce France ? A moins que ce ne soit une armée de fachos, électeurs de Marine, homophobes et ultra-catholiques, tout prêts à répandre leur peste brune sur le sable chaud et citoyen des vacances ?
Pas d’inquiétude. Ce contre quoi les policiers et gendarmes payés par le contribuable sont censés protéger le sacrosaint vacancier en bermuda et crème à bronzer du 1er juillet au 31 août, c’est tout simplement lui-même. Pas-même son voisin qui risquerait, au vu de l’état délabré de la sociabilité, savamment entretenu par la classe dirigeante dans ce pays, pour un oui pour un non, de l’agresser. Non. Si l’Etat bonne maman délègue pour ce triste boulot 3000 gendarmes, ainsi que 2000 agents, CRS et motards, afin de prêter mains fortes aux équipes déjà existantes sur les plages et sur les montagnes, vous avez bien entendu, c’est pour le protéger de lui-même...
Des vacances en toute liberté, en somme. L’Etat protégeant les citoyens d’eux-mêmes. A bien les regarder vivre et penser et consommer, on admet, certes, qu’il y a du travail. Mais tout de même. Tout de même…
On voit bien sur quelle base repose cette propagande. Je prends un exemple : Vous êtes en pleine possession de vos moyens intellectuels, vous partez à la Réunion et vous ne trouvez pourtant rien de mieux à faire que d’aller vous essayer au surf, afin de ressentir quelque chose, une sensation, dire à quel point votre vie sur Terre est fascinante ! Vous voilà donc en train d’aller et venir sur la grande bleue comme un Christ balnéaire sur un Tibériade façon Trigano, quand tout à coup un requin qui vous prend pour une otarie (se trompe-t-il tant que ça ?) vous dénoyaute une jambe. La mer est toute rouge, femme et enfants parcourent la plage en tout sens, un américain crie « My Goodness ! », et une jeune néerlandaise s’évanouit à la vue de votre cadavre rejeté par l’Océan outragé. Finalement, votre mort fait le 20 heures de l’austère Pujadas qui, aussi flegmatique que devant un Tapie déchaîné, lâche : «une nouvelle attaque de requin, que fait l’Etat ? ». Il est vrai que laisser les gens libres et responsables d’eux-mêmes et de leur propre connerie serait, pour certains cercles influents, une atteinte intolérable aux Droits de l’Homme festif et de l’Electeur abruti ; interdire tout simplement le surf serait un acte insensé d’autoritarisme qui risquerait d’être mal vécu « au niveau du ressenti ». Les cercles d’influence préfèrent gérer. 5000 policiers, gendarmes et CRS, donc. Comme le consommateur a pris l’habitude de faire la fête devant les matraques, il prendra bien aussi l’habitude de faire bronzette et toutes les conneries qui vont avec devant des unitormes. « Hélas ! prophétisait Bernanos en 1945, le monde risque de perdre la liberté, de la perdre irréparablement, faute d’avoir gardé l’habitude de s’en servir » (1)
Nous y voilà : Aujourd’hui, Google rend « hommage » à Kafka pour l’anniversaire des 130 ans de sa naissance (ce qui ne manque pas de sel en soi) ; c’est pourquoi, sur sa page d’accueil, on peut voir cette espèce d’horrible Pinocchio en nœud pap’. Ce que les régimes autoritaires ne sont pas parvenus à faire par la répression, les régimes prétendus démocratiques l’ont fait par la prévention : Le monde libre est devenu une gigantesque crèche, surveillée par un Big-Brother aux allures de Big-Nounou socialisante, lequel peut se frotter les mains. Au vu de l’universelle connerie, il est au pouvoir pour longtemps encore. Où faudra-t-il aller pour ne pas être observé, imposé, cultivé, sondé, informé, distrait et – le pire – protégé par l’Etat ? La question mérite d’être soulevée. Au fond de son lit, peut-être. Au fond d’un trou, sans doute. Et encore… Dans son infinie bienveillance, il parait que l’état démocratique prépare une loi sur le comment mourir pour tous, afin de nous y conduire aussi. par la main L’état, qui est un bon bougre, ne dit d'ailleurs pas conduire, mais accompagner. En attendant, le soleil arrive. Réjouissez-vous, et aux plages, citoyens !

(1) La France contre les Robots, Georges Bernanos
08:49 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : france, culture, sécurité, bernanos, surveillance, kafka | 
dimanche, 03 juin 2012
Disparition de K
Après la mort d’un homme, écrivit Kafka, « une fièvre terrestre a pris fin ». Peu après sa disparition survenue le 3 juin 1924, Narodini Listy écrivait ce beau texte :
« Avant-hier est mort au sanatorium de Kierling près de Klosterneuburg, à côté de Vienne, le Dr. Franz Kafka, un écrivain allemand qui vivait à Prague. Peu de gens le connaissaient ici, car il allait seul son chemin, plein de vérité, effrayé par le monde ; depuis bien des années, il souffrait d'une maladie des poumons, et s'il la soignait, il la nourrissait aussi consciemment et l'entretenait dans sa pensée. Lorsque l'âme et le cœur ne peuvent plus supporter leur fardeau, le poumon prend sur lui la moitié de la charge, ainsi la charge est au moins également répartie, a-t-il écrit une fois dans une lettre, et sa maladie était de cette espèce. Elle lui conférait une fragilité presque incroyable et un raffinement intellectuel sans compromis presque terrifiant ; mais lui, en tant qu'homme, avait déposé toute son angoisse intellectuelle sur les épaules de sa maladie. Il était timide, inquiet, doux et bon, mais les livres qu'il a écrits sont cruels et douloureux. Il voyait le monde plein de démons invisibles qui déchirent et anéantissent l'homme sans défense. Il était trop lucide, trop sage pour pouvoir vivre, trop faible pour combattre, faible comme le sont des êtres beaux et nobles, qui sont incapables d'engager le combat avec la peur qu'ils ont de l'incompréhension, de l'absence de bonté, du mensonge intellectuel, parce qu'ils savent d'avance que ce combat est vain et que l'ennemi vaincu couvre encore de honte son vainqueur. Il connaissait les hommes, comme seul peut les connaître quelqu'un de grande sensibilité nerveuse, quelqu'un qui est solitaire et qui reconnaît autrui à un simple éclair dans son regard. Il connaissait le monde d'une manière insolite et profonde, lui-même était un monde insolite et profond. Il a écrit les livres les plus important de toute la jeune littérature allemande ; toutes les luttes de la génération d'aujourd'hui dans le monde entier y sont incluses, encore que sans esprit de doctrine. Ils sont vrais, nus et douloureux, si bien que, presque naturalistes. Ils sont pleins de l'ironie sèche et de la vision sensible d'un homme qui voyait le monde si clairement qu'il ne pouvait pas le supporter et qu'il lui fallait mourir, s'il ne voulait pas faire de concessions comme les autres et chercher recours dans les diverses erreurs de la raison et de l'inconscient, même les plus nobles. Franz Kafka a écrit le fragment Le Soutier (paru en tchèque dans Cernen, chez Neumann), le Verdict, conflit de deux générations, La Métamorphose, le livre le plus fort de la littérature allemande moderne, La Colonie pénitentiaire et les esquisses Regard et Médecin de Campagne. Le dernier roman, Devant la loi, attend depuis des années en manuscrit. C'est un de ces livres qui, quand on les a lus jusqu'au bout, laissent l'impression d'un monde si parfaitement compris qu'il rend inutile le moindre commentaire. Tous ses livres décrivent l'horreur de l'incompréhension, de la faute innocente parmi les hommes. C'était un artiste et un homme d'une conscience si sensible qu'il entendait encore là où les sourds se croyaient faussement en sûreté. »
De passage à Mayence l’année suivante, Alexandre Vialatte, découvrait les écrits de Kafka. C’est grâce à lui que le Procès parut en France en 1933. Je ne sais trop comment Vialatte et ses contemporains lurent Kafka alors. Car je suis convaincu qu’il y a eu une lecture de Kafka d’avant la Seconde Guerre Mondiale, la découverte des camps, Hiroshima, l’absurde, l’existentialisme, et une autre, d’après. La lecture de Listy, sans esprit de doctrine, et celle de l'après-guerre, entièrement revisitée. The Trial sortit en 1962. Deux ans après Psychose, Antony Perkins y brillait entre Jeanne Moreau, Romy Schneider, Madeline Robinson… Et Orson Welles, bien sûr. On peut, sur Daily Motions, revoir la totalité du film. Voici les neuf dernières minutes de cette version de Welles, qui ré-oriente totalement la fin du roman.
02:25 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : kafka, k, kierling, vialatte, welles, littérature | 
lundi, 19 décembre 2011
Vanité du Je
Dans le silence de sa solitude, l’écrivain soucieux de style cherche à ne pas inscrire les mots du monde, les premiers à surgir, tout de suite, à s’imposer. Difficile, car tous ceux qu’il entendit depuis sa naissance lui sont venus de là, du monde. A commencer par celui par lequel sans cesse il s’énonça, et par lequel il se présente encore en levant d’un ongle la visière de sa casquette : celui que tout le monde mâche en bouche pour parler de soi, ce risible, importun, défigurant car si peu figuratif je. Lieu commun, par excellence, territoire de tous. Le je du simple dire.
Avoir depuis toujours qualifié de ce pronom qu’on affirme personnel et qui est si vain son visage, sa pensée, son récit, sa propre sensation, tel est le propre de chacun. L’avoir, ce mot, si souvent accolé à tant d’éléments disparates qui l’ont traversé, d’émois temporels, oui, ce je fugace qui se proclame permanent : l’écrivain n’a donc fort cruellement que ça pour dire tout ce qui s’est passé ; car même s’il préfère en son for intérieur le silence des chats, le relief des couleurs, la résonance des sons, quel autre choix la parole lui laisse-t-elle que de se qualifier au moyen de ce je ?
Pour aussitôt s’en défaire. Car la parole est un tel édifice qu’il faut abandonner cette première clé pour se frotter au il, au on, au nous ou bien encore comme Kafka le fit à la virtuosité d’une simple initiale. Il lui faut, l’écrivain, laisser ce je au monde comme une sale vitre et pourtant, lorsqu’il ferme ainsi son carreau, les profanes croient déjà qu’il impose un masque et le malentendu se tisse. Tout, dans le langage, est vanité.
Le premier des mots du monde étant celui par lequel ce même monde m’apprit à me désigner face aux semblables, alors oui, on comprend de quelle vanité est faite la pate du langage; et que tout l’arbitraire du signe ne soit que déception à l’écoute attentive, et laisse démuni le visage incliné face à la page blanche. Douces, brutales, lancinantes, mornes, fiévreuses, exaltées, douloureuses sont les absences qui me traversent, et m’ont fait masque, que le murmure des mots, malgré cette malédiction, tente d’à nouveau façonner. Je…
Mon corps a une odeur, ma main a une empreinte, ma voix possède un timbre et mon pas son véritable rythme ; parler n’a que ce je à m’offrir, qui comme ce tu n’est qu’une mécanique sourde et sans relief, entonnoir par lequel se recentre sur l’exaspérant lyrisme d’un constant désaccord l’esprit des sept milliards que nous sommes.
Ecrire.
Quand, tel l’habit ôté pour que la peau frémisse, choit ce premier je trop lisse et trop douillet, et qu’un autre s’impose (toujours à son désordre reconnu), la vanité du simplement dire cesse-t-elle enfin pour que débute la témérité de l’art ?
20:50 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : littérature, vanité, l'exil des mots, kafka, dire je |