lundi, 16 juillet 2012
Sans le latin
Sans le latin est un ouvrage collectif dirigé par Cécilia Suzzoni, et que viennent de publier les éditions Mille et une nuits. Seize auteurs y rappellent l’importance diachronique du latin dans la création de la langue et de la culture française : Vérité oubliée, parce que niée jusque dans l’enseignement précaire à présent distillé dans les écoles. A l’heure où, pour la énième fois, la démagogie ministérielle propose de « refonder l’école », alors que les si vaines « sciences de l’éducation » s’apprêtent à reconquérir l’espace de la formation des maîtres, il serait salutaire de se demander pourquoi les « fondamentaux », comme on dit pudiquement rue de Grenelle et ailleurs, ont été si violemment sapé en une quarantaine d’années par les volontés hystériques de réforme et de changement des gouvernants successifs. Ce livre apporte des éléments de réponse. Voici la note de l’éditeur :
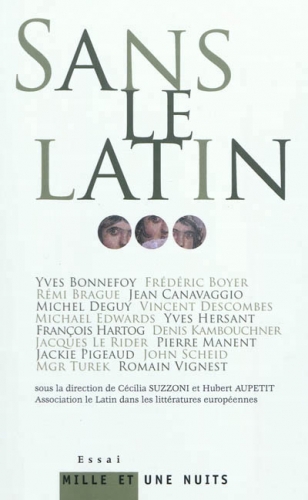
« Sans le latin, sans le latin, la messe nous emmerde » chantait Georges Brassens. Après lui, malheureusement, l’ennui a gagné du terrain, à commencer par celui de l’école, au point que c’est le sens même de notre langue qui finit par se perdre.
Le latin est la langue mère du français et la conscience culturelle de l’Europe. Que goûter de la culture, que comprendre de l’histoire, que savoir de la science et de son évolution, si l’on renie cette filiation?
Alors qu’on exalte le patrimoine avec fébrilité, on liquide, avec une logique soft de taliban, tout ce qui fait l’enracinement du français dans son passé. Sans le latin, c’est tout bonnement notre « roman familial » qui devient illisible. Raconter cette histoire, ce n’est pas idéaliser une sorte d’épopée nationale. C’est se montrer d’abord attentif aux avatars linguistiques et littéraires d’un français qui s’est édifié sous l’égide et la tutelle éclairée de la langue latine.
Chasser le latin, comme on le fait actuellement dans l’enseignement secondaire par toutes sortes de moyens directs ou détournés, c’est désapprendre le français. Organiser la disparition des filières qui permettaient de maintenir un bon noyau de langue et de culture latines chez les enfants de France, c’est rendre inaccessible aux générations futures notre patrimoine littéraire, philosophique et historique ; c’est ramener le français à un simple outil de communication, qui perd toute chance de s’affirmer dans un monde dont la plupart des communications sont désormais assurées dans un anglais pauvre mais commun. On peut rêver : quel président, quel ministre courageux oseront enfin renverser la tendance en instituant le fait latin à l’intérieur même de l’enseignement du français ? »
Seize auteurs, poètes, écrivains et professeurs attachés à des institutions prestigieuses, rappellent avec érudition et simplicité que le latin est encore une langue vivante non seulement en poésie et en littérature, mais aussi en médecine, en science, en droit, en politique, en philosophie, et ce dans tous les pays européens.
Sommaire
Avant-propos, par Cécilia Suzzoni et Hubert Aupetit, « Sans le latin... »
Préface par Rémi Brague, « Perdre son latin »
Conférences, avec les contributions de Frédéric Boyer, Rémi Brague, Jean Canavaggio, Michel Deguy, Vincent Descombes, Michael Edwards, Yves Hersant, François Hartog, Denis Kambouchner, Jacques Le Rider, Pierre Manent, Jackie Pigeaud, John Scheid, MGR Turek, Romain Vignest.
Postface par Yves Bonnefoy, « Le latin, la démocratie, la poésie »
« Faisons un rêve », par Cécilia Suzzoni et Hubert Aupetit
07:40 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : sans le latin, culture, littérature, mille et une nuits | 









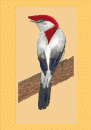
Commentaires
Mon fils, élève dans un petit collège de campagne a fait du latin par correspondance, l'année suivante, un prof de lettres classiques était nommé là où nous avions déménagé, mais elle n'est jamais venue, et donc, point de latin.
Il y a toujours des latinistes dans les établissements de ma ville, collèges et lycées, où c'est une option facultative. Seuls les meilleurs et les plus motivés en font, car bien entendu cette option est proposée à des horaires impossibles....Quand au grec, on n'en parle plus....à la place on fait de l'éducation sexuelle et de l'informatique.
Je suis bien de votre avis,c'est lamentable.
Écrit par : Julie des Hauts | lundi, 16 juillet 2012
Cela dit, je suis d'accord avec vous sur l'importance que l'on devrait accorder aux langues mortes. Je pense que Jean Dutourd serait d'accord avec vous, également! Je regrette de n'avoir pas pu faire du latin alors que je l'avais demander, en sixième. Les effectifs étaient restreints. J'ai pu faire du grec deux ans, en quatrième et en troisième
Ah oui, l'enseignement de l'Histoire n'est plus ce qu'il était, c'est sûr. Voir la place que l'on accorde à l'Empereur. Les profs sont nuls, car recrutés sur concours, ce qui est loin d'être un gage d'intelligence et de culture. L'utilisation du terme fasciste à tout va en est un bon exemple... Bref, il est loin le temps des Malet & Isaac.
Écrit par : Jérémie S. | lundi, 16 juillet 2012
Marie.
Écrit par : Menage paris | lundi, 16 juillet 2012
C'est déprimant, ce constant arasement par le bas. Tout le mystère des choses devient de plus en plus inaccessible par confiscation des clefs.
Écrit par : Sophie K. | lundi, 16 juillet 2012
Écrit par : patrick verroust | lundi, 16 juillet 2012
Elle fait de l'anglais et de l'espagnol, présente ses devoirs sur word, mais ses cours d'histoire ressemblent à des cours d'économie, elle ne situe pas les époques chronologiquement, en éducation musicale elle ne fait pas de solfège, ils écoutent de la musique, on leur fait faire des recherches sur les compositeurs écoutés, mais on ne fait pas vraiment de musique. J'avoue que je ne comprends plus grand chose à ce qui se fait, et encore, j'ai de la chance, elle nous en parle, nous montre ce qu'elle fait en classe. Nous discutons beaucoup, nous l'emmenons dans les musées, elle s'intéresse à mes livres d'art, c'est une bonne petite, mais elle passe trop de temps sur son fichu téléphone que je voudrais voir disparaitre.
Écrit par : Julie des Hauts | lundi, 16 juillet 2012
A savoir en tant que Mgr Turek, de la Secrétairerie d'État du Vatican.
Qu'il "retrace une éclairante histoire du style et des écrits de la Curie romaine", comme l'indique le journal La Croix, est sûrement très intéressant.
Mais il me semble que cette question aurait dû être traitée, soit par monsieur Turek, en tant que personne, eu égard au savoir qu’il en a, soit par un historien de la religion concernée.
En aucun cas par un religieux. C’est donner au Vatican une place qui n'a pas à lui revenir.
Sauf à dire que le latin, c'est la religion catholique romaine et que tous les auteurs de ce livre se rangent sous sa bannière. Ce qui serait du prosélytisme. Ce qu'est peut-être ce livre. Qu'on le dise donc.
Écrit par : Michèle | mardi, 17 juillet 2012
C'est un fait de culture, non de prosélytisme. De la même façon, il me semble quasiment impossible de comprendre la littérature antérieure à 1940 sans connaître la Bible. Je vais vous raconter une anecdote éclairante (si j'ose dire) A Lyon, le 8 décembre, sous Fourvière, était inscrit "AVE MARIA" en lettres lumineuses. Il y a une dizaine d'années, j'ai entendu un type d'une vingtaine d'années dire à sa copine, et pas sur le ton de la plaisanterie, mais celui de l'étonnement ; regarde le "C" est tombé; depuis, le diocèse a remplacé l'inscription par MERCI MARIE, que personnellement, je trouve ridicule.
On a le droit d'être catholique ou pas, mais on ne peut nier quel rôle et quelle place la religion catholique a occupé durant des siècles dans la culture française, jusqu'à la très récente déchristianisation du pays.
Pour finir, Mgr n'est pas un titre (comme monsieur) mais un sacerdoce.
Écrit par : solko | mardi, 17 juillet 2012
Ce n'est pas avec un curé que nous faisons ces visites. Ou si curé il y avait dans le groupe, je ne considèrerais nullement son sacerdoce.
Ce que je veux dire, Solko, c'est que, ce n'est pas parce que la religion catholique s'est développée en latin, qu'on a à écouter un religieux dans un livre qui se réclame de l'histoire de notre langue. Je souhaite, en tant qu'athée, recevoir toutes les connaissances nécessaires sans qu'elles me soient données par un religieux.
Quant à la disparition du latin et du grec dans l'enseignement de base, c'est une ânerie monumentale, mais sûrement pas innocente.
J'ai étudié avec bonheur, le latin et le grec jusqu'en Terminale. Mes parents n'ont pas eu les moyens de me payer des études supérieures, je suis donc devenue institutrice, par la faveur de l’École Normale, bel outil de démocratisation, même s'il était grandement à améliorer. Le latin et le grec sont restés des outils magnifiques de mon approche de la langue.
Écrit par : Michèle | mardi, 17 juillet 2012
Écrit par : solko | mardi, 17 juillet 2012
Reste alors, inépuisable "l'innommé au nom de quoi nous nous taisons". (Blanchot, L'écriture du désastre)
L'attrait du silence comme source d'un sens souverain ne s'appelle pas forcément dieu...
Écrit par : Michèle | mercredi, 18 juillet 2012
Écrit par : Julie des Hauts | mercredi, 18 juillet 2012
Écrit par : Sarah. S. | vendredi, 20 juillet 2012
Les commentaires sont fermés.