mercredi, 29 décembre 2010
Un rêve de linguiste et accessoirement d'illuminé, de fou, de poète
« Il y a eu tout à fait au début du XIXe siècle, en particulier dans la première phase de découvertes que permettait la grammaire comparée, cette idée qu’on remontait aux origines de l’esprit humain, qu’on saisissait la naissance de la faculté du langage. On se demandait alors si c’était le verbe qui était né le premier, ou si c’était le nom. On se posait des questions de genèse absolue.
Aujourd’hui, on s’aperçoit qu’un tel problème n’a aucune réalité scientifique. Ce que la grammaire comparée, même la plus raffinée, celle qui bénéficie des circonstances historiques les plus favorables comme la grammaire comparée des langues indo-européennes, plutôt que celles des langues sémitiques qui sont pourtant attestées aussi à date très ancienne, ce que cette reconstitution nous livre, c’est l’étendue de quelques millénaires. C’est à dire une petite fraction de l’histoire linguistique de l’humanité.
Les hommes qui, vers le XV° millénaire avant notre ère, décoraient les cavernes de Lascaux, étaient des gens qui parlaient. C’est évident. Il n’y a pas d’existence commune sans langue. Il est par conséquent impossible de dater les origines du langage, non plus que les origines de la société. Mais nous ne saurons jamais comment ils parlaient.
L'idée que l'étude linguistique révélerait le langage en tant que produit de la nature ne peut plus être soutenue aujourd'hui. Nous voyons toujours le langage au sein d'une société, au sein d'une culture. Et si j'ai dit que l'homme ne naît pas dans la nature, mais dans la culture, c'est que tout enfant, et à toutes les époques, dans la préhistoire la plus reculée comme aujourd'hui, apprend nécessairement avec la langue les rudiments d'une culture. Aucune langue n'est séparable d'une fonction culturelle»
Emile Benveniste - Problèmes de linguistique générale 2 - 1974

1878 : C'était l'âge d'or de la linguistique, cet objet devenu depuis, avec le structuralisme, si austère : le temps des Bréal, des Saussure, des Meillet. Meillet fut le maître de Benveniste dans les années 20. Je ressens quelle passion, quel moteur, cela pouvait constituer pour ces chercheurs contemporains de Pasteur, de Littré et de Darwin, l'idée de revenir aux sources de la culture afin d'embrasser un fragment pur de la nature. Quelle déception cela dut être ensuite, de ne trouver, in fine, aux origines de la culture encore, que de la ... culture, tristement et bêtement humaine. Et encore, de la plus récente qui soit, de la culture niaisement romantique... On ne s'échappe pas si facilement de l'humaine finitude...
09:38 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : linguistique, lascaux, benveniste, littérature | 









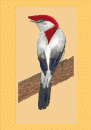
Commentaires
Apprendre que le néolithique a été la première vague d'extinction linguistique de notre histoire, qu'au moment de cette révolution néolithique il y avait entre 5 et 9 millions d'hommes sur toute la planète, à peine la population d'Île-de-France aujourd'hui ; que ces chasseurs-cueilleurs parlaient des centaines, voire des milliers de langues. Et qu'avec l'invention de l'agriculture (inventée quasi simultanément en plusieurs endroits du mode : il y a 12000 ans au Proche-Orient, 10000 ans en Chine, dans la vallée du fleuve Bleu, et plus récemment en Amérique du Sud ; synchronisme étonnant dû au réchauffement climatique à la fin de la dernière glaciation), donc de la domestication des céréales, la démographie humaine s'emballe. Comme les céréales et le bétail permettent de nourrir plus de monde que le gibier et les fruits, les populations d'agriculteurs croissent assez vite, se répandent, et avec elles leurs langues. Celles des chasseurs-cueilleurs ont tendance à disparaître, parce que ceux qui les parlent ne peuvent vivre dans les zones défrichées et se réfugient dans les collines, les montagnes, ou se déplacent. Plus l'importance économique des agriculteurs s'agrandit, plus les locuteurs des dernières langues paléolithiques finissent par les abandonner et ne plus parler que celles des agriculteurs, dont le nouveau mode de vie se répandra sur toute la planète, excepté la Nouvelle-Guinée, l'Australie, certaines régions d'Amérique et d'Afrique.
L'indo-européen remonte peut-être (origine encore controversée) à une langue de paysans du sud de l'Anatolie où le blé a été domestiqué il y a 11000 ou 12000 ans.
En Europe l'expansion indo-européenne a éliminé les langues les plus anciennes comme l'étrusque ou les langues ibériques, dont on a gardé des traces mais qui ont complètement disparu sauf dans l'ouets des Pyrénées où, le relief fournissant une certaine protection, l'ancêtre basque a résisté.
Le basque serait donc une langue du paléolithique ; son origine reste très obscure, c'est un "isolat" comme disent les linguistes, une langue qui n'est apparentée à aucune autre. L'hypothèse la plus raisonnable est que le basque soit le descendant des langues parlées par les populations paléolithiques, celles qui nous ont laissé les grottes de Lascaux. Ce serait donc la seule langue survivante en Europe de la grande extinction linguistique du néolithique.
Écrit par : Michèle | mercredi, 29 décembre 2010
Écrit par : solko | mercredi, 29 décembre 2010
Pour moi, les Basques évoquent moins le béret que l'attaque de l'arrière-garde de Charlemagne, dans la Chanson de Roland.
Écrit par : Feuilly | mercredi, 29 décembre 2010
Écrit par : Sophie K. | mercredi, 29 décembre 2010
Écrit par : Sophie K. | mercredi, 29 décembre 2010
Les illustrations des grottes sont toujours étonnantes de délicatesse. Ces peintres possédaient un langage et une culture, sans aucun doute, ne serait-ce que parce qu'ils symbolisent leur univers
Écrit par : Zoë Lucider | mercredi, 29 décembre 2010
@ Sophie : Rousseau disait, lui, que la langue primitive était le chant, faisant de l'homme une sorte d'oiseau. L'idée était jolie même si, je crois que vous avez raison, nous devons la langue aux marchands.
@ Zoé : Je ne connais pas le hongrois, mais nous avons un spécimen à l'Elysée. Faudrait lui poser la question de l'origine de sa langue...
Écrit par : solko | jeudi, 30 décembre 2010
Écrit par : patrick verroust | vendredi, 31 décembre 2010
Écrit par : solko | vendredi, 31 décembre 2010
Je ne suis pas un pédago mais mine de rien, j'ai fait réussir des élèves en difficultés en leurs contant, entre autres, l'histoire de cette manière burlesque. La réalité dépasse en burlesque toute fiction et défie l'imagination. La "vérité historique" est pétrie de calembredaines.
Écrit par : patrick verroust | samedi, 01 janvier 2011
Que cette année vous soit "utile" . Pour l'an suivant, le mot d'ordre sera "hausse toi de là que je l'y mettes"
Votre billet et le commentaire de Michèle sont passionnants. Merci à vous deux.
Écrit par : patrick verroust | samedi, 01 janvier 2011
C'est marrant, le progrès et l'évolution, cela marche pour tout sauf pour le langage. Le premier homme serait-il un dieu omniscient?
Si cela vous intéresse, nous parlons européen...
Stéphane Feye
Schola Nova - Humanités Gréco-Latines et Artistiques
www.scholanova.be
www.concertschola.be
www.liberte-scolaire.com/.../schola-nova
Écrit par : Pr Stephane Feye | mercredi, 29 mai 2013
Les commentaires sont fermés.