mardi, 13 juillet 2010
La Table de Claude (9)
Les tables claudiennes, donc, mystérieuses à plus d’un titre.
D’abord, à la manière que les adultes avaient de prononcer leur nom-même, en claironnant bien glaudiennes, et non claudiennes. Leur instinct populaire confondant, aurait dit un philologue du XIXème ici fort réputé, l’empereur Claude et le Père Glaudius. Le Littré de la Grande Côte, ouvrage érudit s’il en est, que je ne découvris que bien plus tard, apporta de fait sa caution scientifique à cette rudimentaire fidélité des gens de ma tribu à l’accent de leurs propres parents, puisque le nom Claude n’y apparaît qu’à la lettre G, et sous cette forme : « Glaude, Glaudine, bonne prononciation de Claude, Claudine »
Ensuite à la façon qu’avaient ces mêmes adultes de ne jamais dire « chez moi », comme tant d’inconscients le disent un peu partout à présent, mais, pour parler de l’endroit où ils auront vécu quelques saisons, lorsqu’il s’agissait par exemple de décider si l’on ferait tel repas de famille chez l’un ou chez l’autre, de simplement préciser, qu’on passerait cette année Noël aux «Tables glaudiennes » plutôt qu’à « Choulans », c'est-à-dire chez ma mère plutôt que chez sa sœur. Il faut dire que personne, ni à Choulans, ni aux Tables glaudiennes n’était vraiment chez soi, c’est-à-dire vraiment propriétaire, puisque que tout le monde y payait, comme l’écrivit un jour le bon Céline dans Mort à Crédit, un terme. Ceux des « tables glaudiennes » depuis des temps plus immémoriaux que d’autres (me semblait-il) puisque c’est là qu’avait habité le grand père, là qu’habitait encore la grand-mère, là, le foyer initial, la ruche dont tous étaient partis et où ma mère seule était revenue un jour, avec un marmot de quelques mois sous le bras. Antiques, donc, ces Tables ! Et pourquoi pas aussi vieilles que celles de cet empereur au nom imprononçable et dont je ne savais rien, sinon que tel Dieu celles de la Loi, c’est lui qui avait autrefois, jadis, et même auparavant encore, fait graver cette phrase dont l’autorité résonnait de façon presque magique à mon esprit : « il faut sauver la Gaule chevelue »…
Dernière chose enfin qui ne laissait pas de m’étonner : ce chiffre de 32 qui leur était toujours accolé ; qui, parfois, leur servait même de substitut : « Cette année, fêtera-t-on Pâques au trente-deux ?», entendais-je parfois autour de moi - comme si n’existaient ni le trente et un ni le trente trois. J’ignorais alors le distinguo subtil entre métonymie et synecdoque, mais j’entendais avec plaisir ce langage imagé, fleuri : Car ce « trente-deux des Tables glaudiennes», d’où la vue était si belle, dont le carrelage était si rouge, et que peuplaient de si beaux chants d’oiseaux, était riche d’une si longue fréquentation familiale, profond d'une habitude du lieu qui remontait à si loin avant ma naissance qu’à mon oreille ce chiffre-même a merveilleusement conservé le diapason du gîte, et ces deux tables une empreinte immuable et immanquablement consolante, quelque tourneboulement indû que le monde ait pu subir par la suite.

00:00 Publié dans La table de Claude | Lien permanent | Commentaires (5) | 









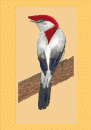
Commentaires
Est-ce que habiter cela va de soi ?
Écrit par : Michèle | mardi, 13 juillet 2010
A Louise dans la maison aux volets verts, "qui ouvrait (chaque matin à la même heure), d'abord au premier étage puis au rez-de-jardin, le bois grinçant de ses volets qu'elle refermait, d'abord au rez-de-jardin puis au premier (chaque soir à la même heure)..."
Écrit par : Michèle | mardi, 13 juillet 2010
Écrit par : romain blachier | mardi, 13 juillet 2010
Galvaton
Écrit par : Glaudine | mardi, 13 juillet 2010
@ Romain : Quelle étrange association. Quelque chose de latin ?
@ Glaudine : A peu cha !
Écrit par : solko | mardi, 13 juillet 2010
Les commentaires sont fermés.