lundi, 28 décembre 2009
Parole de profs
Se refaire un silence, comme on dit se refaire une beauté, une santé ou une virginité. Un prof passe son temps à blablater devant des groupes d’élèves qui l’écoutent, ou font semblant, ou encore ne l’écoutent pas. La plupart des profs qui savent que leur parole est imposée se consolent en la songeant essentielle (phobie, par exemple, de ne pas finir le programme…) ou bien, au moins, d’une quelconque importance. La plupart tentent de la rendre intéressante. Voire attrayante. Peu acceptent vraiment de comprendre à quel point la parole du savoir est devenue accessoire et, comme le reste, noyée dans la consommation. Paroles de classe qu’il faut tenir, comme le soldat tient son rang.
Et puis après ?
Les paroles des profs, comme le reste de leur personne, sont surtout regardées.
Paroles épiées jusqu’au trognon, par ennui ou désœuvrement. Très rarement par intérêt ou par passion. Avez-vous remarqué combien, ici ou là, rien n’échappe au regard d’un groupe de gens qui s’ennuient ? Commères, jadis, derrière leurs jalousies : l’éternel humain n’a pas d’âge ni de renouveau, au contraire de ce qu’espère le populo. Surtout quand il croit à la modernité du monde et au renouveau du printemps. Regardez-les, par exemple, en train d’attendre le bus, et de quêter du regard dans la grisaille environnante du paysage ce qui pourrait les divertir un peu de cette attente désobligeante. Les êtres humains sont semblables sur les bancs de la classe. Le droit d’écouter leur MP3 en moins. Quand on coupe le MP3, ils sont enfermés dans le bocal, ils n’ont plus que cette parole de profs pour horizon…
La parole du prof est sortie du dialogue, extirpée de l’échange, interdite de bavardage. Elle n’est jamais réplique, et condamnée au monologue, elle s’étire en toile de fond comme ces couleurs ternes sur la tôle du hangar où seraient peints des textes de loi. Elle doit être à sa façon et séduisante, et volumineuse, et variée, et aussi mener quelque part comme les routes nationales ou les lignes de bus qui sillonnent les banlieues : autant dire qu’elle est vouée à l’échec de l’ordinaire.
Quand de plus cette parole se retrouve instrumentalisée, tel le muscle du prolétaire ou le sifflet de l’agent, puisqu’elle devient la seule force de production de celui qui la détient et qu’au terminus de chaque mois, elle lui amène le salaire, la parole a besoin de repos.
Le repos de la parole.
Je dis : se refaire un silence, comme se refaire une beauté, une santé ou une virginité.
19:50 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : noël, vacances | 









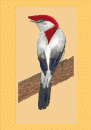
Commentaires
Écrit par : tanguy | lundi, 28 décembre 2009
Écrit par : calystee | lundi, 28 décembre 2009
Écrit par : solko | mardi, 29 décembre 2009
Écrit par : Marie-Hélène | mardi, 29 décembre 2009
Très intéressant votre texte. Ce que vous décrivez n'est-ce pas l'ennui ou les interrogations que tout un chacun éprouve à un moment donné concernant son travail professionnel. On s'interroge sur l'utilité de ce que l'on fait, sur le sens. Quand bien même le métier que l'on exerce nous passionne et qu'on l'a choisi par vocation. Que doivent alors ressentir ceux qui font un métier uniquement pour des raisons alimentaires, un métier routinier et pénible (manutention, préparateur de commandes...)?
Écrit par : pier paolo | mercredi, 30 décembre 2009
Écrit par : solko | mercredi, 30 décembre 2009
Écrit par : solko | mercredi, 30 décembre 2009
Les commentaires sont fermés.